Tell me how you really feel

Découverte il y a deux ans, l’Autralienne Courtney Barnett devient la nouvelle muse d’un rock indé, libre et décoiffé. On se sent bien avec elle !
Elle a tout de suite avoué : elle a appris la guitare en écoutant Nirvana. Et tous les groupes qui faisaient la révolution au début des années 90. La boucle est bouclée dans son deuxième album. Les survivants de cette époque trainent désormais dans son studio d’enregistrement.
Kim et Kelley Deal des Breeders viennent donner de la voix sur ce nouvel album, très attendu. L’exercice du second essai est toujours redoutable. Futée, Courtney Barnett a réalisé un faux second album avec son ami chevelu Kurt Vile. Tell me how your really feel n’est donc pas le retour décu ou heureux de la chanteuse.
En tout cas, elle prouve ici qu’elle a Nirvana et toutes ses sources dans son rock épuré et si mélodieux. On ne va pas la comparer à PJ Harvey, Liz Phair ou Courtney Love. Elle a tout d’une grande et surtout on entend quelqu’un qui se livre. Le titre de l’album est juste : le sentiment passe dans la musique.
C’est parfois un peu âpre mais la vie et la passion de Courtney Barnett se mêlent dans cet album rouge sang où elle donne l’impression de jouer sa peau avant tout. C’est de l’écriture spontanée et surtout maitrisée.
Elle sait déverser des décibels comme elle se sait calmer le jeu mais jamais, elle trahit sa conviction d’aimer la musique et d’y mettre toutes ses émotions. Loin d’être une écorchée vive (quoique), elle vibre sur chaque couplet, chaque rythme. C’est un disque vraiment troublant par sa sincérité.
On peut reprocher un manque d’originalité mais sa passion pour le son des années 90 réveille un peu face aux standards de la musique actuelle. L’Australienne se sent dans son élément, le rock ; nous on se sent très bien avec elle.
Pias - 2018
Roukiata Ouedraogo, Je demande la route


Un one woman-show qui fait éclater les rires et éveille les consciences, du Burkina à Paris.
Des bancs de l’école au Burkina, aux chroniques sur France Inter en passant par le salon de coiffure, le cours Florent et la chambre sous les toits, Roukiata met en scène avec auto-dérision son parcours. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.
Il fait bon faire une pause avec Roukiata, on se sent comme au Burkina. On retrouve les expressions, les intonations. L’humoriste s’étonne ainsi que les hommes en France offre des fleurs et pas de la nourriture comme en Afrique. "Vous avez une drôle de façon de draguer en France. Des fleurs ! Mais qui vous a dit que je mange ça ! La drague passe le ventre avant le cœur"
Son quatrième spectacle est l’occasion d’évoquer des sujets plus épineux, les limites de la mondialisation, l’excision, les préjugés, la solitude, le froid qui chicotte, le manque des proches, la perception des attentes de part et d’autre.. Sur scène apparaissent les personnages qui l’ont conduit à être ceux qu’elle est, par leur présence ou leur absence. Au terme de ce parcours initiatique c'est une Roukiata devenue une femme accomplie et sûre de ses choix qui reviendra au pays, retrouver les siens.
1h30 d’humour, de finesse, de réflexion intelligente sur le monde
Il lui en aura fallu du courage, de la persévérance, de l’autodérision pour s’affirmer et faire sa place en France. Mais elle en eût et son spectacle est une leçon de vie pétrie d’amour pour son pays. Elle partage ses histoires des Mossis, ses exceptions culturelles comme la parenté à plaisanterie : le mode de résolution des conflits par la plaisanterie (ah si seulement il pouvait s’appliquer ici aussi).
On en sort avec le sourire, l’énergie de poursuivre ses rêves et de tracer son chemin. Salle comble à Paris, elle est attendue pour fouler les planches d’Avignon. Bravo l’artiste !
Texte et mise en scène : Roukiata Ouedraogo, Stéphane Eliard
Festival Off d’Avignon 6 au 29 juillet 2018, Théâtre du train bleu
Le Maître et Marguerite, Mikhaïl Boulgakov, Igor Mendjisky, la Tempête

Un spectacle enivrant qui fait voyager dans le temps et dans différentes dimensions !
C’est en alternant, avec une énergie folle, les trois récits que comprend l’œuvre de Boulgakov et en injectant malicieusement des images, des interactions avec le public, des morceaux de musique improbables et de l’humour toujours, qu’Igor Mendjidky remporte le pari de nous transporter (même s’il lui arrive aussi de nous perdre) à travers l’un des monuments les plus extravagants et complexes de la littérature russe.
Armé d’une audace indéniable, Igor Mendjidky est également magnifiquement épaulé par ses comédiens, au premier rang desquels Romain Cottard et Alexandre Soulié qui jouent admirablement leurs rôles d’êtres pas tout à fait humains, un chouia diaboliques mais quelque part quand même un peu séduisants et aimables. L’emploi de vidéos projetées sur le fond de la scène, soit pour emporter vers ailleurs, soit pour donner de la perspective allant même retransmettre des scènes tournées en direct sur un autre coin de la scène, est un exemple parmi d’autres de l’imagination et de l’ingéniosité dont Igor Mendjidky peut faire preuve pour créer de nouveaux univers et sortir du temps en emportant le public avec lui.
Ainsi, Le Maître et Marguerite, actuellement au théâtre de la Tempête, réjouit et galvanise par son énergie, sa liberté, sa créativité et son humour. On regrette juste de ressortir sans être parvenu à élucider le message de l’œuvre de Mikhaïl Boulgakov qui reste bien mystérieuse.
Jusqu’au 10 juin 2018 à la Tempête
Le Maître et Marguerite
De Mikhaïl Boulgakov
Adaptation et mise en scène par Igor Mendjidky
SLUFF

Un trio de musiciens aux cheveux sales qui jouent avec nonchalance du coté de Seattle. La comparaison avec un fameux groupe du coin apparait rapidement, pourtant Naked Giants ne doit pas être vu à l’ombre d’un géant.
Car c’est un embryon du groupe punk ! Ils jouent avec approximation mais ils concentrent une telle énergie que l’on est obligé d’apprécier le travail bruyant de Gianni Aiello, Henry la Vallee et Grant Mullen, trois joyeux drilles qui prennent la vie du bon coté.
Ils font du rock pour s’amuser, taquiner et oublier les misères du quotidien. Ils produisent une espèce de musique légère en montant les amplis à fond et en chantant un peu n’importe comment. Ils aiment visiblement le contre pieds.
Ils dégradent donc une sorte de surf music avec des décibels libérés et en font un rock faussement crétin. Car derrière les structures tiennent le coup face au jemenfoutisme apparent et coloré, qui fait d’ailleurs tout le sel de la pochette de l’album.
Sur la terre du grunge, les efforts électriques du trio ne sont pas une réelle surprise mais on doit reconnaitre qu’il y a derrière tout l’arsenal rock détraqué, une petite poésie qui pointe, que l’on connaissait chez Big Star et tous ses rockeurs qui décrivaient si bien l’american way of life.
Crétin mais pas bête. Bruyant mais mélodique, ces Géants Nus sont de petits emmerdeurs que l’on va adorer !
Solo: a star war story

Tout le monde lui est tombé dessus. Avec les tumultes qu'a connu le film, Solo ne pouvait que se faire massacrer par la critique. Les spectateurs n'ont pas l'air de suivre non plus. Dommage, car le film de Ron Howard n'est pas si mauvais... bien au contraire.
C'est un film avec des défauts. Okay. Mais quel film de Star Wars n'en a pas? Vous voulez qu'on parle des Ewoks? Vous voulez qu'on parle de la trilogie sur la genèse de Dark Vador? De mes yeux vus, je n'ai pas croisé un personnage comme Jar Jar Binks dans Solo?! Avec la descente aux enfers que le film a subi, on a le droit d'être indulgent.
D'autant que la première partie du film est réussie. Un petit coté vieux comics des années 60, pulp à la Richard Corben ou Metal Hurlant. On ne sait pas si on la doit aux réalisateurs virés ou à Ron Howard, mais elle est emballante, rythmée et surtout elle échappe un peu aux conventions si lourdes d'un Star Wars classique avec la Force, Mark Hamill qui fait la tronche ou des couchers de lune sur la musique de John Williams.
D'ailleurs, au passage, le travail de John Powell, un peu aidé par Williams, sur ce nouveau film franchisé est un vrai bonheur de cinéma. La musique sécurise parfaitement lorsque les faiblesses du long métrage sont un peu trop visibles à l'écran. On est clairement dans un esprit d'aventures. La musique jongle avec les acrobaties du Faucon Millenium et les idéaux de Han Solo. Ca faisait longtemps qu'une BO de blockbuster n'était pas aussi flamboyante.
Avec son sourire en coin, Solo découvre donc la vie de contrebandier de l'espace. Le film s'intéresse à ses premiers pas, à son mentor et sa rencontre avec Chewbacca, valeur sûre et poilue de la franchise Star Wars.
Avant d'être cet hors la loi au coeur tendre, Han Solo était donc un fougueux jeune homme, amoureux et volontaire, toujours à l'affut des mauvais coups, pour en tirer le meilleur parti. Il vit donc mille aventures et obtient ses galos de pilote hors pair et héros malgré lui.
Il est certain que le film n'est pas grandiose mais il a le mérite d'assumer son statut de redite obligée. On sait tout de Solo donc le film s'amuse à parodier les westerns ou les vieux films de guerre. C'est très ludique à défaut d'être profond.
Avec sa production houleuse, Ron Howard rassure avec son talent de faiseur indéniable. Moins prenant et tragique que Rogue One, ou que la trilogie en cours, Solo semble se contenter de son aspect divertissant. Han Solo dans la saga originale, était déjà celui qui détendait l'atmosphère!
Pas de grande déception donc mais pas d'énormes attentes aussi, il faut l'avouer. Le résultat est agréable, avec un casting intrigant et, on doit le rappeler, une musique originale que l'on n'écoutait plus depuis très très très longtemps. C'est désormais la BO d'une galaxie far far far away!
Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke et Donald Glover - Disney - 23 mai 2018 - 2h10
Demi Soeurs

Portrait simple des jeunes femmes trentenaires qui peuplent Paris. Un peu trop Femme Actuelle mais souvent charmant.
Lauren vit dans un rêve: elle se voit en styliste à Paris. Elle a dû mal à joindre les deux bouts en réalité et vit un calvaire dans le milieu de la mode et des décideurs. Salma est professeur dans une zep. Courageuse, elle a tout de même du mal à lacher sa famille. C'est le cas aussi de Olivia qui rêve de l'homme parfait et veut sauver son père de la dépression.
Elles ont la trentaine et encore beaucoup de rêves. Le destin leur joue un drôle de tour: un père en commun qui disparait et la propriété partagée d'un appartement dans le 7e arrondissement. La cohabitation n'est pas facile mais petit à petit, les jeunes femmes vont faire tomber leurs préjugés et s'aider mutuellement...
Dans la forme, nous sommes bel et bien dans la petite production française qui ne prend pas de risques et qui fait tout pour être programmé à la télévision en prime time. Les réalisateurs Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne sont sages. Bien trop sages lorsqu'on apprécie le pitch de cette comédie parisienne.
Car il s'agit bien de Paris et ses femmes! Le film observe simplement la citadine, ses réseaux, ses failles et ses barres de rire. Pour le coup, le casting est parfait: le film doit être vu pour le trio de comédiennes qui d'habitude ont des rôles plus anecdotiques au cinéma. Sabrina Ouazani, découverte dans l'Esquive il y a des milliers d'années, confirme une fois de plus son incroyable charisme. Alice David échappe aux clichés sur la potiche pétasse. Charlotte Gabris fait un festival comique en toute discrétion.
Entre elles, le courant passe et c'est bel et bien ce qui sauve le film du pur produit de consommation. Grace à elles, le film passe bien le message sur les femmes d'aujourd'hui. Sans être girl power ou féministe jusqu'à l'obsession!
On aurait aimé un peu moins de situations vaudevillesques et un peu plus de sensibilité mais on est sous le charme. Au delà du discours sur le vivre ensemble, il y a aussi un trait sur la solitude moderne et le besoin d'appartenance. Mais il s'agit d'une comédie légère. Elle n'en fait pas trop. Elle permet à des actrices de briller. Non franchement, il ne faut pas bouder son plaisir quand il est là!
Avec Sabrina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris et Patrick Chesnais - SND - 30 mai 2018 - 1h40
Monsoon
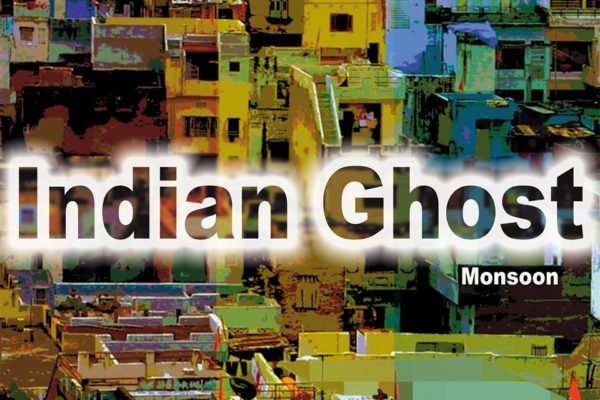
Les Toulousains de Indian Ghost ont logiquement enregistré leur nouvel album en Inde. Ca sent bon l’encens, le curry et la pop volatile.
Le groupe Indian Ghost n’est pas très productif. C’est ce qui rend le rendez-vous précieux lorsqu’ils annoncent la sortie d’un album. Car ces musiciens sont assez imprévisibles. Ils ne regardent pas vers le futur. Ce ne sont pas de grands novateurs. En tout cas, c’est de l’artisanat solide et louable.
Depuis 1993, cinq albums. Tous différents. Trois ans après Lost far gone, ils se sont perdus en Inde. Evidemment les tablas et les sitars se sont invités dans leur créativité. Don Joe, le leader du groupe, a emmené ses copains du coté de Benares. Cela donne évidemment un disque psychédélique.
On pense aux Beatles mais les Toulousains apportent leur touche personnel avec une pop légère, sensible à l’environnement et qui se gorge de tout l’exotisme que peut offrir le pays riche en sonorités et ambiances.
Nous sommes en face d’un disque d’atmosphère. C’est un périple. Courageux et audacieux. Une fois encore, on regarde un peu dans le rétro mais ce n’est pas grave : ils réveillent le plaisir « patchouli » des années 60 et de utopies enfumées sans faire l’erreur de la pale copie.
Facilement, Monsoon est un voyage. Avec ses pauses, ses joies et peut être ses doutes. C’est toujours bien d’avoir un regard nouveau sur un lointain pays. Les vacances approchent. Ce disque est une invitation à l’exil !
Pop sisters pias - 2018
Berlin Kabarett, Stéphan Druet, Théâtre de Poche Montparnasse


« Berlin Kabarett »: que voilà un titre intéressant et prometteur. J’imaginais déjà le monde interlope de l’entre-deux guerres, sous la république de Weimar, les dernières années fastes avant la haine nazie. Homosexuel(le)s, hétérosexuel(le)s, tout le monde voulait s’amuser de façon effrénée. Bref, on pouvait espérer passer un bon moment. Ou, tout au moins, intéressant. Hélas, le spectacle est décevant.
Certes, les décors sont réussis, une prouesse dans cette petite salle en sous-sol qui se prête davantage aux monologues ou aux dialogues. De la lampe de bureau à la TSF en passant par les téléphones et les tentures, on s’y croirait.
La mise en scène offre aussi quelques bonnes trouvailles. Jeux de lumières qui évoquent le cinéma burlesque mais aussi enregistrements de bombardements et de discours d’Hitler... On reconnaît également la patte d’Alma de Villalobos, la chorégraphe des « Caramels fous ».
Mais… Car il y a un mais. Voire plusieurs. Le texte, tout d’abord. Chaque scène pourrait être réussie. Des petites filles habillées en tyroliennes (Eva Braun ?) à l’hommage à « L’ange bleu », en passant par « Cabaret » et « Portier de nuit », on éprouve un sentiment de « trop ». Trop long. Redondant. Pourquoi insistent-ils donc ainsi, rajoutant des phrases qui nuisent à l’effet ? Résultat : la fin de presque chaque scène tombe à plat. Mauvaise chute. On aurait envie de dire : « Mais non, arrêtez-là, enfin, c’est lassant ». Voire lourd.
Quant aux voix, elles n’envoûtent pas, ne charment pas, hormis celle du pianiste, Fritz (Stéphane Corbin). Victor, le fils de Marisa Berenson (interprété par Sebastiàn Galeota) chante ou trop fort ou pas assez, et sa voix est parfois un peu terne. Dommage, car l’interprète a une réelle présence.
Marisa Berenson (Kirsten) est peu crédible en femme sans scrupule qui couche avec les nazis parce qu’il le faut bien. Son jeu manque de relief et d’inventivité. On ne croit pas une seconde à la haine qu’elle éprouve à l’égard de son fils. Et sa voix ne convainc pas. Ses longues stations assises au bureau à feuilleter quelques papiers, fume-cigarettes à la main, auraient pu se transformer en saynète touchante de femme murmurante, se penchant en voix off sur ses erreurs passées.
Outre ces remarques, on s’interroge sur un autre comportement récurrent : quel besoin de mimer à tout moment la sodomie ? Quel intérêt ? On se doute bien que dans ces lieux, les garçons ne s’adonnaient pas au tricot ou à la belote. Au bout d’un moment, ça devient ennuyeux et surtout vulgaire. Bref, une fois encore, il y a redondance.
L’auteur Stephan Druet précise qu’il a écrit « Berlin Kabarett » en quelques semaines. Peut-être aurait-il dû prendre plus de temps.
Jusqu’au 15 juillet 2018
Du jeudi au samedi 21H. Dimanche 17H30.
Tél. 01 45 44 50 21
75, bd du Montparnasse, 75006 Paris
www.theatredepoche-montparnasse.com




