The Color in anything

Il a la mêche comme il faut. Il porte le petit t.shirt sans forme. Il a un petit look frêle. Il a un air introverti. Il est pourtant le chouchou de la presse avec ses chansons modernes et tristes. Pour accompagner la pluie...
James Blake a tout du timide brillant. Il a de la suite dans les idées et des envies d'ailleurs. Il s'évade avec quelques sons électro et une voix délicate. Surnommé "Prince de la vallée du vent", James Blake a réchauffé les coeurs avec un album frais, Overgrown en 2013. Il a connu un beau succès et récupéré le Mercury Prize, récompense grandiose au Royaume Uni.
Donc inutile de vous dire que le garçon était attendu au tournant avec son troisième album. Une fois de plus il joue sur la mélancolie contemporaine. La pochette fait penser plus à Nick Drake qu'à un petit génie du bidouillage. Pourtant une fois de plus, il démontre sa science des montages sonores.
Reconnu, il a désormais des copains célèbres qui viennent collaborer. On croise donc dans son disque des personnes différentes comme Franck Ocean ou Bon Iver. On se dit que le jeune chanteur porte la solitude comme un fardeau mais cette fois ci, le producteur des Red Hot et légende américaine, Rick Rubin participe à la production.
Est ce que cela change beaucoup de choses? Non pas vraiment. Les points forts sont là: James Blake réussit toujours aussi bien à écrire des titres tristes avec des moyens modernes pour nous embrouiller dans de belles émotions et de spectaculaires morceaux soul, quasi futuristes. Sa voix est incroyable.
Mais elle se métamorphose sur 76 longues minutes. Certes elles sont denses ces minutes car Blake est en recherche permanente. Mais l'ennui pointe aussi le bout de son nez à force d'expérimentations. Sorti sans prévenir, cet album abonde de générosités en tout genre et ca finit par être un peu usant.
Sa passion pour la musique quasi abstraite, au croisement de tous les styles, finit par englober dans ce disque tout et rien. On est parfois agacé. Parfois fasciné. Le disque ne laisse pas de marbre. C'est déjà ça. Mais effectivement, sa couleur n'est pas assez définie. Et donne une impression de fadeur. Bizarre après 76 minutes d'efforts!
Polydor - 2016
Gelsomina, Pierrette Dupoyet, Studio Hébertot


Zampano est un colosse de foire brutal, un vagabond, avec une force de Gladiator, un cœur de pierre. Il ne sait parler qu’en criant, en donnant des ordres, en jurant, habité par cette hâte d’aller vers nulle part.
Gelsomina, lui a été vendue par sa mère. Petit bout de femme lunaire, pétrie d’humanité, de poésie, elle accepte de suivre Zampano sur la route car elle voit en lui une vie d’artiste qui la fait rêver. Quelle ne sera pas sa désillusion quand elle se retrouvera longtemps cantonner aux tâches ingrates.
De village en village, de place en place, les deux âmes blessées cohabitent. Sans pour autant se comprendre. Ils ne vivent pas dans le même monde.
Zampano ne compte que sur sa force physique. Gelsomina s’interroge sur le monde qui l’entoure : « Comment on devient une femme ?» « Comment trouver les mots justes pour exprimer ce qu’on ressent ». Elle se met à penser par elle-même, à avoir une opinion, à s’affranchir.
Gelsomina va grandir au contact de la dureté de Zampano. Elle n’arrivera pas à l’adoucir mais elle puisera une force pour apprendre à dire non, pour comprendre qu’elle n’est pas une moins que rien.
Elle souhaite que quelque chose de beau sorte d’elle. Alors quand sa vie croise celle d’un funambule, musicien, ses yeux se mettent à briller. Elle va « boire du rêve à grandes gorgées » avec lui, être éblouie, apprendre à jouer de la trompette. « Je me suis sentie artiste », dira-t-elle. Mais les trios ne durent jamais bien longtemps et le drame se profile…
Dans une langue poétique imagée de Pierrette Dupoyet, la comédienne Nina Karacosta donne toute une palette d’émotions à Gelsomina. Elle habite le plateau, déploie le personnage, le révèle, le rend très attachant.
« Le spectacle nous confie l’histoire de ces « gens sans importance » laissés au bord de la route, ceux dont la vie ne semble compter pour rien, que l’on piétine, dont on se détourne sans voir que l’on passe à côté d’un être humain, d’une vie, d’un petit trésor. Sans jamais se plaindre, en faisant preuve d’une impressionnante force de vie, d’une volonté de voir le meilleur en tout, Gelsomina témoigne pour tous les laissés pour compte, les petites gens, les différences,… »
Jusqu'au 03 juillet 2016
Ocean by Ocean

Ce n'est pas bien. Ce n'est pas mauvais. C'est le syndrôme des disques de suiveurs qui rêvent sûrement de gloire et de beauté!
On aime bien se moquer de The Boxer Rebellion quand on sourit face à un peu d'ambition et les rêves de gloires. Car, à coup sûr, depuis une dizaine d'années, les quatre Londoniens se verraient sûrement bien comme une alternative bandante à Coldplay, qui a déjà pris la relève de U2.
L'Américain Nathan Nicholson et ses trois copains britanniques travaillent donc pour s'installer sur le marché américain. Ils cherchent et trouvent de temps en temps le hit parfait mais le résultat n'est pas là: ils restent surtout un petit groupe anglais capable de quelques chansons pour publicité. Pourtant il y a tout: l'écriture héroïque, une voix haute et profonde, une guitare qui lache des notes à toute vitesse et des refrains imparables.
On parle même d'eux dans la comédie romantique fort sympathique, Trop loin pour Toi. Depuis des années, le groupe fait tout pour se faire remarquer. Mais il ne se passe pas grand chose en dehors des frontières européennes. En tout cas on est loin du succès écolo-poli de Coldplay.
Il faudrait peut être un peu musclé le jeu mais The Boxer Rebellion continue dans la pop commerciale. Mais propre. Ca ne va pas vous écorcher les oreilles. C'est lisse mais parfaitement produit. Tout est bien placé pour vous faire taper du pied ou vous coincer sur un rythme accrocheur. Nicholson et ses potos ne manquent pas de talent!
Ils ont cependant un manque cruel de caractère. Tout ce qu'ils font est joli. Mais on n'est jamais surpris. Il n'y a pas de folie ou de grande originalité. Ca fait passer le temps de manière agréable. A la différence de la pochette, on n'est pas vraiment bousculé par une vague de fraîcheur. Et de la nouveauté!
Pour la révolte, il faudra repasser plus tard certainement.
Amplify - 2016
Souvenir de l’empire de l’atome

Ambiance Mad Men pour de la science fiction de papa. Un régal pour les yeux.
Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse ont visiblement la tête dans les étoiles. Ils les observent même. Comme leur héros, Paul qui vit dans un monde beaucoup plus étrange que les apparences. Ce binoclard discret est tout de même en contact avec un héros extra terrestre et ce lien va provoquer toute une série de catastrophes et aiguisée les appétits de pouvoir d'ennemis de tout poil.
Et c'est parti pour une longue et belle lecture quand on en voit rarement. Les deux auteurs s'amusent beaucoup à retranscrire les utopies des années 50, quand la croissance et le progrès s'engouffraient dans la même voie. Le dessin est évidemment rétro et assez naïf.
C'est un vrai bonheur pour nos mirettes. On baigne dans des décors éclatants et délirants. La mélancolie de Paul colle bien à l'environnement vintage et les amusantes représentations d'une autre civilisation tirée d'une série b italienne. C'est toujours respectueux et très beau à voir. Il faut imaginer une compromis entre Star Trek et Mad Men.
D'autant que le scénario est serialesque en diable. C'est peut être un peu répétitif mais on s'amuse comme des petits fous devant cette course poursuite quasi sans fin. Ca nous fait dire que "c'était mieux avant" mais on est ravi de découvrir maintenant deux talents et une bédé au charme désuet et indéniable "where no man has gone before"!
142 pages - Dargaud
Everything at Once
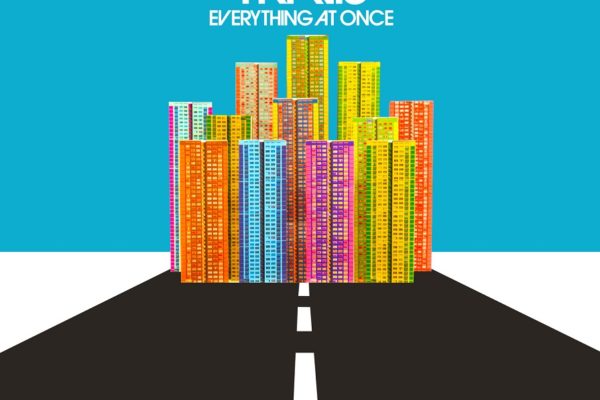
Revenu de tout, le groupe écossais Travis s'amuse et cela s'entend: leur huitième album compile joyeusement les ritournelles pop sans se soucier du temps qui passe.
D'ailleurs on est impressionné par la voix de Fran Haley. Toujours aussi guillerette et capricieuse. Il a la voix éternelle d'un adolescent qui jubile. Pourtant le look du chanteur a beaucoup changé. On dirait désormais un petit hippy barbu au regard particulièrement malicieux.
Il faut dire que plus rien ne fait peur à Travis. Il a connu un énorme succès (mérité) à ses débuts avant de devenir un groupe discret toujours soucieux de défendre la pop, la vraie, l'anglaise, la mélodique. Le quatuor ne veut pas révolutionner le genre. Travis est à la recherche de bonnes chansons.
Cela a donné des albums maladroits. Parfois, les quatre Ecossais se plantent. De temps en temps ca fonctionne. C'était le cas du précédent disque, revigorant et rappelant l'intelligence du chanteur, capable de jouer sur plusieurs registres. Le groupe a t il encore le mojo aujourd'hui?
Dans leur huitième opus, Tout en Un, il y a tout ce que l'on aime chez Travis. Toujours sur la base classique de basse guitare batterie.Même s'ils font intervenir ici où là d'autres instruments pour jouer avec les stéréotypes. C'est quand il joue le dépouillement le plus naturel que Travis est très bon. Car il possède un excellent chanteur, qui sait envahir nos oreilles avec des petites nuances qui font toute la profondeur de son style bien à lui.
Caroline records - 2016
X Men Apocalypse

Alors est ce que c’est bien les X-Men contre le schtroumpf grognon ?
Ce dernier est né à l’époque de Stargate. Cette époque est idéale pour créer des monstres cruels et belliqueux qui ne pensent qu’à réduire les Hommes à l’état d’esclaves. Apocalypse, son nom en dit long sur le personnage, serait donc le tout premier des Mutants. Evidemment il est hyper fortiche et les mutants d’aujourd’hui auront bien du mal à calmer ses morbides envies.
Le précédent volet se passait dans les années 70 donc logiquement nous découvrons les Mutants des années 80. Cela nous vaut une bande son à base d’Eurythmics et des brushings qui rendrait jalouse Une Nounou d’enfer !
Initiateur du tout premier X-Men sur grand écran, Bryan Synger connaît bien son univers et les comics. On devine qu’il touche sa bille pour faire vivre des personnages kitsch mais finalement assez touchants.
Il a surtout la bonne idée de réunir un chouette casting. Michael Fassbender est parfait pour jouer l’ambigu Magneto, qui se prend un peu pour Dark Vador. On s’amusera d’ailleurs de voir comment le réalisateur d’Usual Suspects emprunte beaucoup à la saga intergalactique. Il doit être un peu vexé de ne pas être appelé sur la nouvelle trilogie.
Il a aussi la qualité de multiplier les personnages et de leur donner de l’épaisseur. Si on rigole devant les costumes bien ringards des sbires du Schtroumpf grognon, on apprécie qu’ils ne soient pas de simples rouages pour un scénario qui cherche les morceaux de bravoure à répétition.
Puisqu’il faut comparer avec les autres héros Marvel, les X-Men, depuis trois films, développent avec un charme certain, une vraie envie de cinoche d’aventures, une galerie de super héros attachants, qui dépassent les contraintes visuelles, parfois maladroites. Cela justifierait presque les quelques passages assez rudes pour une production Marvel.
Blockbuster, le film fait tout de même l'effort de ne pas gommer les moments réellement cruciaux et un peu craspec. Il y en a pour tous les goûts. Peu de sang mais pas de cadavres en fin de compte. Par exemple, Singer assume enfin la personnalité animal de Wolverine, qui se fait remarquer dans un bref passage sous haute tension. Ca nous console de sa série propre, un peu insipide.
Cela justifierait presque les quelques passages assez rudes pour une production Marvel. Blockbuster, le film fait tout de même l'effort de ne pas gommer les moments réellement cruciaux et un peu craspec. Il y en a pour tous les goûts. Peu de sang mais pas de cadavres en fin de compte. Par exemple, Singer assume enfin la personnalité animal de Wolverine, qui se fait remarquer dans un bref passage sous haute tension. Ca nous console de sa série propre, un peu insipide.
Il est vrai que l'on en voit beaucoup des types en collants qui ont des devoirs et des responsabilités parce qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Mais la bande de professeur Xavier a quelque chose de différent. Sa relecture de l'Histoire, sa noirceur, ses ambiguïtés assumées et ses thématiques échappent un peu aux conventions de ce très envahissant genre né il y a une quinzaine d'années! Et ce n'est pas fini... Il faudra apparemment compter sur les X Men.
Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence et Oscar Isaac - 2h20 - 20th century fox - 2h20
Stiff

Cela existe encore: des disques de rock où la jouissance est la clef de voûte! Septième album d'un groupe texan méconnu, Stiff vous file la banane même si sur la pochette il est question de cactus. Un album piquant.
Piquant et savoureux! A l'initiative, James Pitralli et trois autres musiciens d'Austin ne sont pas respectueux des clichés du genre: il n'y a pas de barbe à la ZZ top pour cacher leurs élans électriques et s'ils aiment le blues rock, ils apprécient aussi les choses plus calmes comme le jazz et des choses plus mélodiques. Pour se bourrer la gueule à la bière dans la poussière du désert, ils ne proposent pas vraiment la bande son idéal.
Au fil des disques, White Denim a défendu un rock assez cool, qu'on pourrait juger d'hédoniste! La satisfaction, le plaisir et le bonheur sont au coeur de leur projet mélomane. Ils semblent un peu hors du temps avec leur rock désuet mais pas du tout éthéré. Ils ne font pas dans le psychédélisme échevelé ou dans les longues digressions virtuoses.
Ils se situent quelque part en 38 Special et Big Star s'il fallait chercher des références. Il y a à la fois de la technique musicale et une recherche assez simple d'une éternelle adolescence ou d'une jouissance subtile. C'est très simple mais en même temps, il y a une déferlante d'innocence qui ne se conjugue avec de la niaiserie.
Ils font remonter ce rock plein de candeur, qui loue l'amitié, le travail et le plaisir. En plus la pochette prouve qu'ils ont de l'humour ce qui ajoute au charme old school mais réel de Stiff.
Downtown - 2016
Anna Karénine, Léon Tolstoï ,Golshifteh Farahani, Gaëtan Vassart, Théâtre de la Tempête


Splendide interprétation de l’héroïne du roman de Tolstoï par Golshifteh Farahani.
Très rarement adapté au théâtre en français, le colossal roman de la grande littérature russe prend une cure de jouvence et de douceur persane sur les planches audacieuses de la Tempête.
Anna Karenina est mariée à un haut fonctionnaire avec qui elle a un garçon de six ans. Elle choisit de vivre ouvertement sa passion adultère avec Alexis Vronski, officier, en dépit des menaces de mise au ban de la société. Daria, enceinte jusqu’au cou apprend une nouvelle tromperie de son mari. Et Kitty a son cœur déchiré entre Lévine, jeune idéaliste propriétaire terrien épris d’absolu et Vronsky. Ces trois femmes naviguent entre désir d’émancipation, de bonheur et contraintes sociales et familiales. Et constatent combien un moment d’égarement d’une femme et d’un homme ne déclenche pas les mêmes bouleversements.
Dans un décor minimaliste, la mise en scène de Gaëtan Vassart mêle univers originel russe et français. Le côté décalé ne marche pas toujours. Son adaptation apporte cependant des touches d’humour et de modernité bienvenues au texte fleuve de Tolstoï.
Golshifteh Farahani est extraordinaire. Elle joue une Anna mélancolique et joyeuse, fragile et puissante, sensuelle et envoutante. L’actrice iranienne éblouit de sa voix chantante et nous révèle des talents de pianiste. Elle impressionne par sa mémoire d’un texte complexe traduit en français. Quand on pense qu’à son arrivée en France il y a huit ans elle ne parlait pas un mot de français… Son interprétation vibrante d’émotion n’est pas sans évoquer son émancipation personnelle des convenances sociales en Iran l’ayant conduit à l’exil. Vivement sa prochaine montée sur les planches entre deux montées des marches. Chapeau l’artiste !
Jusqu'au 12 juin 2016
Et le Docteur Mamour mourra…


Il est assez dingue de voir à quel point, dans la vie de tout à chacun, de tous les jours, dans la vie tout court, le vulgum pecus est d’une façon que nous pourrions qualifier « d’assez générale » profondément phobique des hôpitaux.
Peut-être, tout simplement, parce que ça suinte, ça hurle, ça couine, on y bouffe mal, et que même pour la naissance de tes enfants, il y fait chaud, il y fait lumière néon qui claque les yeux, il y fait odeur d’un produit qui te pique le pif, il y fait interne d’origine pakistanaise un soir d’urgence qui te dit que si tu as la jambe droite fracturée c’est forcément que t’as pas dû manger correctement, qui quand il te demande sur une échelle de 1 à 10 tu as mal à combien et que tu réponds 9 ½, bah le mec ricane en te traitant de fiotte qui en rajoute et que quand le radiologue le croise 3h plus tard à 1m de toi, toi qui est toujours bien sûr comme un con souffrant le martyre dans un brancard tout près d’une vieille qui hurle et d’un clodo qui sent bon comme une décharge radioactive de Tchernobyl, le mec lui annonce qu’en effet, 9 ½ c’est pas con comme remarque car tu as triple fracture ouverte du péroné, bah là, oui, forcément, t’as juste envie de te lever, mais tu peux pas, de courir, mais tu peux pas, et de lui déboiter la tronche façon « demain mec même ta mère va pas te reconnaitre », mais tu peux pas ; et tu confirmes ainsi la théorie populaire de phobie généralisée à l’égard et des internes qui parlent moyen la langue et de l’hôpital en général. Petit message d’amour au passage au gentil interne qui m’avait diagnostiqué une simple crise de foie et prescrit 2 doliprane en conséquence, juste 2h avant ma belle péritonite, bisous d’amour enf****.
Oui mais voilà, cette phobie, une fois le prime time venu, bien coincé dans son canap’, le même vulgum pecus, souvent vulgum pecus femelle soyons honnête, devient follement attiré par le même univers constitué de brancards, de blouses blanches, de perfusions, de vivants sauvés, de mourants qui meurent, de vivants qui se meurent, de mourants qui ressuscitent, le tout de « Urgences » à « Nurse Jackie » en passant par « Dr House » et du, j’y viens j’y viens doucement ça va hein je tease je tease, sacro-saint « Grey’s anatomy » sur fond d’histoires d’amour, d’histoires de cul, d’histoires de mœurs, d’histoires de loose, d’histoires de baise, d’histoires de vies, d’histoires de morts, d’histoires de d’amours vivantes sauvées ou encore d’histoires d’amours mourantes qui ressuscitent, je tourne en rond, eux aussi d’ailleurs.
Ok ok, les aficionados crieront aux parjures, me fouetteront à grand coup de sangles à garrot avec des bouts de seringues plantées pour mieux me fesser, ohhhhhhhhh ouuuuiiiiiiiii vas-yyyyyyyyyyy sal***** d’infirmière souffle moi dans ma grosse intubation et injecte moi 35 de CC pour faire monter mon pouls, vas-y oui choque moi, oui choque moi, oui on dégage, oui bip moi jour et nuit, oohhhhhhhhhh ouuuiiiiiii…en m’affirmant haut et fort que non de non, chacune des séries qui se déroulent in the hospital in the USA des Etats-Unis de l’Amérique, l’Amérique, je veux la voir et je l’aurai, n’ont rien à avoir les unes avec les autres, que non de non, George Clooney dans Urgences ne tient pas du tout le même rôle du beau gosse que le Dr Sheppard peut tenir celui du beau gosse dans Grey’s, qu’il y a de nombreuses nuances, quasiment cinquante, d’où une très logique cinquante nuances de Grey’s.
Le véritable avantage de ces séries in the hospital, est que même quand tu les loupes durant 3 saisons, dans la mesure où certains qui étaient partis reviennent comme par magie, certains qui étaient normalement morts dans un effroyable accident de la route ou de bus ou d’avion ou d’hélico, bah en fait je vous le donne en mille ne sont pas forcément partis ou pas forcément morts pour de bon, non, ils reviennent, tatatatatatatataaaaaaaa !!!
Idem pour les histoires de fions fions cul cul slip zizi, car à chaque fois le chef des urgences est avec l’infirmière qui le trompe avec un interne qui lui-même couche avec la pharmacienne qui n’est autre que la maitresse de la femme du mari de l’infirmière qui se tape, donc, en loose, le chef des urgences et que, 3 saisons plus tard, bah après que tout le monde se soit touché façon vas-y que je te mélange le rubik’s cube à smiley cœur avec les doigts, et bien tout est revenu comme avant puisque le chef des urgences est avec l’infirmière qui le trompe avec un interne qui lui-même couche avec la pharmacienne qui n’est autre que la maitresse de la femme du mari de l’infirmière qui se tape donc, en loose, le chef des urgences, mais qui a changé entre temps, mais elle se le tape quand même, la sal******* mais ohhhhhhhhh ouuuuiiiiiiiii vas-yyyyyyyyyyy sal***** d’infirmière souffle moi dans ma grosse seringue et injecte moi cette fois-ci 85 de CC pour faire monter mon pouls à 198, vas-y oui choque moi, oui choque moi, oui on dégage je sais oui on dégage, mais vas-y oui bip moi jour et nuit, oohhhhhhhhhh ouuuiiiiiii, le toute généralement avec des enfants qui sont apparus entre temps, dont un noir d’origine béninoise, car oui, dans le milieu hospitalier, on aime adopter lors de passage éclair en Afrique pour une mission humanitaire expliquant l’absence d’un des personnages durant une, ou deux, ou trois saisons.
Oui mais voilà, des fois, des scénaristes en ont dans le slip, ils n’ont peur de rien, sachant pertinemment qu’aujourd’hui 95% de leur public est féminin sur un canapé et que leurs mecs, dans l’infime espoir de voir d’un œil une saaaaaaalll***** d’infirmière à gros boobs entre deux pages de pub, restent sur l’autre canapé avec une tablette dans la main à regarder la rediff de « Jour de Foot », ils ne désespèrent pas de lui faire lâcher sa dite tablette avec un événement choc, un truc qui fait dire à la vulgum pecus femelle à son ours de mec « haaaaaannnn mais c’est pas vrai regarde, nooonnnnnn, mais c’est pas possiiiibbbllleeee, regarde, lâche ta tablette, regarde »…et c’est comme ça, que durant cette 128ème saison de Grey’s, le Docteur Mamour mourra.
Voilà.
Allez, j’vous embrasse, ooooohhhhh oooooooouuuiiiiiiiii !
Aladdin
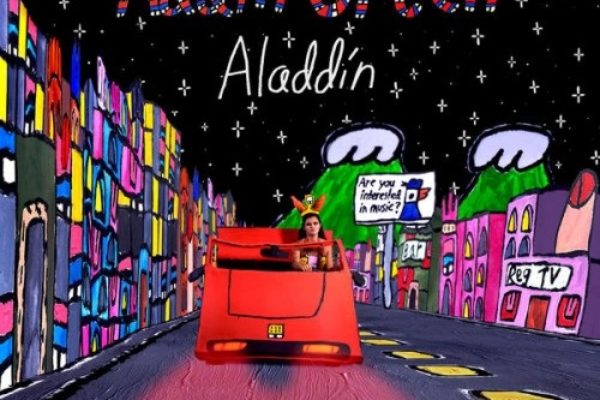
Comme un génie dans sa lampe, Adam Green réalise un de nos voeux les plus chers: l'album le plus rigolo de l'année.
Depuis plus d'une dizaine d'années, le folkeux Adam Green compose de petits titres sympathiques, entre humour et poésie, avec une pointe d'attitude hippy pour plaire à tous les futurs hipsters. Il a connu un certain succès mais se faisait plus discret, préférant sa formule underground plutôt que de se compromettre avec des grosses compagnies.
C'est un parfait new-yorkais, qui à 35 ans, commence à ressemble à une version loufoque de Lou Reed dans la voix et continue de faire du Bob Dylan pour les enfants: des chansons courtes, drôles, à la fantaisie douce amère. Il poursuit donc sa trajectoire très particulière en adaptant le mythe d'Aladdin avec ses propres moyens, limités mais enthousiastes.
Il a fait un film et surtout il a écrit une petite vingtaine de ritournelles, capricieuses et souvent irrésistibles. Il joue le sale gosse du folk. Adam Green est un Peter Pan qui refuse le monde des adultes même s'il le caricature (avec élégance tout de même) par ses chansons très new yorkaises.
Il raconte donc sa sauce la fable des mille et une nuits: c'est du bricolage incroyable mais parfaitement assumé. Il veut célébrer l'innoncence et la puissance de l'imagination. Il y a donc un film coloré et fauché et ce disque nettement plus abordable car on y entend Green continuer ses expéditions vers un art léger et sincère, s'amusant de tout et gratouillant des refrains entêtants et réjouissants. Il nous appelle à ne pas grandir:après ce disque plein d'humour, on veut bien le suivre!



