The Party

En 1968, la critique n’a pas été tendre avec la comédie de Blake Edwards. Le temps a réparé l’injustice : The party est un pur joyau burlesque et un fol écho de l’époque. L’humour à chaque vision devient un peu plus évident ! Essentiel pour le samedi soir détente!
Avec The party, Blake Edwards voulait se moquer gentiment du cinéma désincarné des années 60, celui d’Antonioni plus particulièrement. La presse n’a pas apprécié et a descendu cette nouvelle comédie avec Peter Sellers.
Ce dernier joue un personnage à la Jacques Tati. Hrundi V. Bakshi n’est qu’une excuse pour exposer une galerie de farfelus, aussi grotesques que pathétiques. Cela n’empêche pas le personnage principal d’être attachant. L’acteur donne une candeur charmante à cet artiste indien maladroit invité par hasard à une soirée chez un puissant producteur.
Avec le temps, Bakshi deviendra un personnage culte. Il restera comme une grande figure du burlesque à l’état pur. Car le film est un vibrant hommage à l’humour physique et absurde. On pense évidemment à Buster Keaton et Charles Chaplin.
Sellers détruit tout sur son passage avec une blancheur hilarante. Dans un monde surfait comme le cinéma, tant de naïveté amène obligatoirement un lot de catastrophes de plus en plus énormes.
Le film accélère les gaffes avec une imagination qui à chaque fois surprend. Il développe encore une idée de Tati, la mécanisation des êtres. Le film montre des humains pris au piège d’un maladroit mais aussi d’une maison à la pointe de la technologie. Les invités ne sont plus que des pantins, victimes de leur dépendance et de leur orgueil.
Chaque personnage est une source de gags plus ou moins visibles. Derrière la farce loufoque, Edwards épingle les travers de ses contemporains avec une férocité, peut être pas si drôle que cela !
Cette vision du désordre montre que le cinéaste comique avait bien compris son époque et qu’il était peut être le plus clairvoyant. Le bouffon a toujours raison !
Le Syndrome de Cassandre – Yann Frisch – Théâtre du Rond-Point

Yann Frisch et le clown existentialiste
C’est coincé derrière un « mur mou » translucide, entre un bureau capricieux et une mère séquestrée dans une malle que Yann Frisch a décidé d’emprisonner son clown de théâtre. Avec comme seules armes sa magie et son imagination, le clown de Frisch évite de charger le plateau d’un comique mécanique et linéaire. Le cadre est vite posé. Le clown commence l’histoire en essayant de la finir, allumette à la main.
Il est seul, vif et grinçant. En dérangement perpétuel et instable. Mange des bananes. Tourne dans sa cage. Questionne le sens du réel et le rôle du fictif. Essaye de convaincre que la magie n’existe pas, tout en en maîtrisant tous les codes. Il est sans être vraiment, en lévitation entre être et non-être. Le syndrome de Cassandre rend fou. Frisch bouscule les frontières de la représentation jusqu’à celles du spectateur.
Ni vraiment clown comique, ni vraiment magicien, il se cherche clown de théâtre. Tente d’enlever en vain son nez noir. Tente l’inclusion dans le mode du spectateur. Cligne des yeux nerveusement devant l’angoisse du néant. On suit le clown, ses détournements contrôlés de la fiction. Le spectateur devient méfiant devant la tournure que pourrait prendre la fiction. La frontière est sensible, poétique. Haute voltige théâtrale, Frisch casse l’espace et les codes. Parfois maître de l’illusion, parfois valet du réel, son clown déambule en cage à la recherche du soi. Une mise en abyme existentialiste du clown de théâtre.
On rit jaune, on rit gris, on rit peur. La farce, méli-mélo de fiction et de réel, ne peut que mal finir. Un très beau numéro de clown tragique.
http://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/le-syndrome-de-cassandre/
13 Hours

Michael Bay, le gros bourrin du cinéma américain, fait dans la géo stratégie et les conflits au Moyen Orient. Mine de rien, son film est une bonne surprise
Michael Bay représente à peu près tout ce que l'on peut détester du cinéma hollywoodien. Des histoires faméliques. Des dialogues de cours de récréation. Des acteurs qui servent d'accessoires. Des effets pyrotechniques qui se mesurent à des effets spéciaux démesurés. Des bimbos qui s'installent sur les gros plans inutilement. Des montages épileptiques. De la musique assourdissante. Des drapeaux américains qui flottent au ralenti.
Bref, dans le genre, la boursouflure filmique est la marque de fabrique de Michael Bay. Sa saga des Transformers est une bouillie sans fin d'images ineptes et crétines. Mais Michael Bay a des velléités auteurisantes. Avec No Pain No Gain, il se moque lui même de son cinéma, de son style et de ses comédiens!
Désormais, il veut se frotter à un genre sans le violer: le film de guerre. Il se veut (et 13 Hours les cite ouvertement) quelque part entre Alamo et La Chute du Faucon Noir. Et ce n'est pas faux: pour une fois, Michael Bay respecte des règles de cinéma en respectant le temps et le lieu, deux données essentielles dans les films d'assaut!
Bonne surprise car 13 Hours n'est pas si réactionnaire qu'on l'imagine. Bay observe 6 mercenaires qui pour le compte de la CIA assure la protection d'une base secrète à Benghazi en Lybie, un des endroits les plus dangereux au Monde.
Les gars font les marioles jusqu'à ce qu'une bande de terroristes décident d'attaquer les lieux protégés. Le combat n'est pas équilibré et c'est ce qui fera la grandeur de ces six types armés jusqu'aux dents! Car ils vont tout faire pour défendre une bande de gratte papiers insolents et des directeurs d'agence qu'on jetterait bien au milieu de djihadistes défoncés!
Leur professionnalisme fait que ce désastre géo stratégique devient un beau fait d'armes, raconté avec une verve beaucoup moins hystérique que d'habitude chez le réalisateur d'Armaggedon. Bien entendu les hommes sont très virils mais les comédiens (dont l'excellent John Kasinski) sont bien choisis. Evidemment il y a de l'action et des explosions. Il y a aussi des facilités narratives qui agacent. Il y a aussi des effets visuels mais ils n'embellissent pas la guerre. Jamais!
Récemment Des Larmes et du Sang d'un autre bourrin,le réalisateur Peter Berg, faisait lui aussi dans le fait de guerre qui va au delà des idées reçues et qui n'est pas forcément glorieux pour l'Amérique. 13 Hours est une autre variation du "Seul contre tous" militaire. Bay y découvre que le temps peut être allié pour le récit. Il fait d'autres découvertes: on a bien l'impression qu'il se rend compte de ce que peut être le cinéma. La preuve: le drapeau américain qui vole au ratenti prend très cher dans ce film plutôt convaincant et saisissant!
Avec John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini et Pablo Schreiber - Paramount - 30 mars 2016 - 2h24
Girl at the end of the World
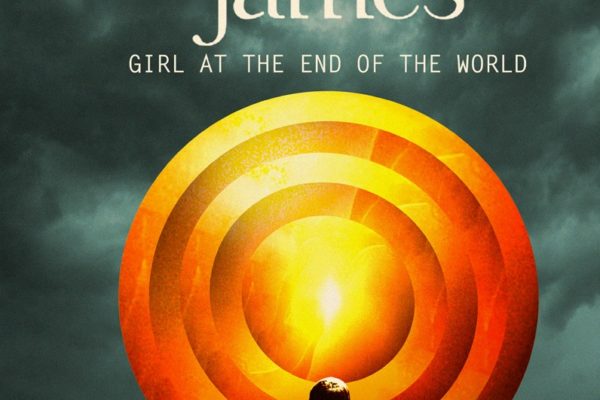
C'est le grand truc de ce début d'année 2016: le groupe de britpop qui a connu quelques succès dans les années 90 entre les deux gros faiseurs de tubes, Oasis et Blur. Après Suède, Kula Shaker ou Primal Scream, James à son tour remet le couvert.
Mais depuis sa reformation en 2007, le groupe de Manchester n'a pas vraiment arrêté. On peut leur reconnaître une vraie vitalité. Ils n'ont pas chômé entre longues tournées et albums studios en pagaille. Mine de rien, James n'a pas vraiment beaucoup percé chez nous mais il a 25 millions d'albums écoulés à son actif. Une vraie petite institution qui a fait un break de sept ans en 2001 et 2007.
En 2016, le chanteur Tim Booth et ses amis sortent donc le 14e album de James et montrent qu'ils ont encore la forme... et pas mal d'humour car la fille de la fin du monde n'est qu'une prostituée selon le titre du premier morceau, exaltant et très instrumental. To my surprise confirme qu'après trente ans de carrière, James sait toujours écrire une chanson typiquement british, avec un chant nasillard pas si désagréable et un refrain entêtant.
La suite de l'album sent bon le fish & chips et on a bêtement l'envie de lever les bras en l'air sur quelques refrains, d'entrer en communion avec son prochain, aidé d'une bonne pinte. Ou plusieurs! C'est l'Angleterre dans toute sa splendeur. Populaire dans le bon sens du terme. On aurait l'impression de traverser le vieux pub jamais vraiment essoré, au charme quasi champêtre.
Il y a des nappes de synthés et des riffs sympatoches. On s'imagine en bonne compagnie, avec de vieux potes qui ont un brin de nostalgie et une envie intacte. Ils ne font rien de neuf ou de transcendant. Ils font ce qu'ils savent faire après des années d'expérience. Le disques réunit simplement quelques titres généreux qui vont ennuyer les pointilleux mais qui pourront attendrir les autres. Pas de quoi provoquer l'apocalypse musical, ca c'est sûr!
Infectious - 2016
Par delà les marronniers, Jean-Michel Ribes, Rond Point


Énigmatique.
Jean-Michel Ribes dit vouloir saluer “l’insolence d’être” et “la liberté de la différence”, mais le choix de la revue et du music-hall, avec la présence de danseuses-chanteuses auprès des dadaïstes Jacques Vaché, Arthur Cravan et Jacques Rigaut, laisse perplexe. Même si on sourit aux répliques assassines d’Arthur Cravan (interprété par Michel Fau) qui fait part de sa détestation de l’art et prend pour cibles Marie Laurencin et Robert Delaunay, l’ensemble est décevant- quant à la découverte très limitée que l’on fait de ces personnages - et triste.
Tout autour une ambiance caricaturale de music-hall, au-dessus l’omniprésence de la guerre qui flotte comme une chape de plomb et, au milieu de la scène, les trois dandys dadaïstes défilent l’un après l’autre. Est-ce un choix de ne pas trop dévoiler de leurs personnalités hors normes? Les comédiens (Maxime d’Aboville, Michel Fau et Hervé Lassïnce) semblent sous-employés et on en est mal à l’aise et déçus de ne pas percer même un tout petit peu du mystère de leurs personnages.
Plutôt que de la folie, de la désinvolture ou un sentiment de liberté absolue, c’est finalement du spleen qui émane le plus des dadaïstes mis en scène par Jean-Michel Ribes, tristes et sans illusion face au pouvoir de l’ordre moral.
Par delà les marronniers Revu(e)
Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes
Avec Maxime D’Aboville, Michel Fau, Hervé Lassïnce, Sophie Lenoir, Alexie Ribes, Stéphane Roger, Aurore Ugolin
Au Théâtre du Rond Point jusqu’au 24 avril 2016, 20h30
Life in Pause

La musique est un raffinement pour Jack Tatum, l’homme qui se cache derrière le nom exquis de Wild Nothing. Une espèce de brocanteur qui chine des vieux sons classieux du rock !
Il y a peu, nous évoquions les chanteurs qui se glissent dans l’ombre pénétrante de Ian Curtis, symbole du chanteur rock torturé qui écrit pour survivre à ses dépressions. D’autres envisagent la musique comme une collection de mélodies qui doivent faire du bien aux oreilles.
Car la musique peut être un divertissement. Pour les masses mais aussi pour les exégètes, les passionnés et les curieux. C’est d’ailleurs ce vilain défaut qui faire la qualité des disques. Jack Tatum fait de la musique comme on chine en brocante. On devine que c’est la curiosité qui l’a poussé à choisir des orchestrations étranges.
Pas si bizarres. Puisque Tatum aime visiblement, comme beaucoup de monde en ce moment, les années 80. Du fin fond de sa Virginie, il s’est pris de passion pour la pop britannique des eighties. Il pioche dans les vieilles choses pour leur redonner de l’éclat et de la modernité. Les chansons de son groupe, Wild Nothing donne cette sensation qui se révèle assez agréable.
Donc on n’a pas droit à de la tristesse infinie prise dans le piège d’une introspection mélodique (pas mal non ?) mais à une version décalée de ce son eighties, léger et synthétique. Comme sur sa pochette d’album, Jack Tatum s’accapare le meilleur des années 80 mais le recycle avec une habileté qui donne de l’éclat aux guitares, aux synthétiseurs et aux harmonies vocales si significatives de cette grande époque.
Il ne fait pas du neuf avec du vieux. Il rend hommage au vieux avec un goût certain. C’est du travail méticuleux. Cela s’entend et cela rend bien : on échappe aux clichés. On n’est pas dans la déprime glaciale de la cold wave ni dans la vague pop des Modern Talking. On se promène dans des mélodies entêtantes avec des couches de sons qui se déposent harmonieusement les unes sur les autres.
On pense un peu à Lloyd Cole ou les chansons les moins énervés des Cars. Ce ne sont pas les références habituelles et cela fait toute la différence même si on peut se demander si on doit encore avoir des albums de maintenant pour se rappeler de ceux qui marquèrent notre passé… vaste débat !
Captured tracks - 2016
Is the is are

Diiv recycle le son indie lo-fi de garage des années 80 90 avec un certain talent et beaucoup d’excès en tout genre. Mais le groupe relève plus du story-telling qu’autre chose !
Diiv, groupe de Brooklyn, c’est surtout et d’abord le jeune et talentueux, Zachary Cole Smith. Gringalet toxique, il a passé beaucoup trop de temps dans les stupéfiants en tout genre pour ne pas passer inaperçu. Ses compositions sont marquées par son expérience difficile. Il est une figure du rock indé au point de jouer aussi le top model déclassé.
En 2016, il tente de s’en sortir avec l’écriture de 300 chansons. Il en retient seulement dix-sept pour réaliser le second disque de son groupe très shoegaze, influencé par le rock underground des années 80 90, quelque part entre Sonic Youth et les Smiths.
Une âme torturée qui joue de la musique hantée ! Ce n’est pas nouveau. Et l’influence de la new wave et de la cold wave, ce n’est pas non plus très originale. Mais bon ça fait toujours parler. Et en plus il y a une très jolie couverture « art brut » qui fait son petit effet.
En étant différent, Zachary Cole Smith colle pourtant bien aux étiquettes de l’âme damnée du rock, du petit paumé qui s’exorcise en suant sur scène, sur des sons vaporeux et une guitare cristalline. Bizarrement, après écoute, tout ceci sonne un peu creux.
On devine bien l’élan de survie du compositeur de 31 ans qui étale ses angoisses sur un double album. Mais on n’entend pas grand-chose qui surprend ou nous inspire. C’est joliment fait mais on en a vu d’autres qui se sont sacrifiés sur l’autel de la création. Les morceaux s’enchaînent mais aucun ne sort vraiment du lot. C’est sûrement un disque d’ambiance. Comme le titre du disque, il y a comme un bégaiement chez les rockeurs sombres, new yorkais et existentialistes !
Captured tracks - 2016




