Combien coûtent nos vies ?, Pauline Londeix, Jérôme Martin, 10/18


« Combien coûtent nos vies ? » se situe entre une étude et un plaidoyer. Les propos sont très étayés et documentés.
Au fil des pages le lecteur est de plus en plus dérouté face à ce texte à sens unique : l’industrie pharmaceutique serait très loin de la philanthropie et serait uniquement guidée par le profit.
Cette réalité était déjà grandement dévoilée dans l’excellente série DopeSick.
Le livre va plus loin en précisant que les bénéfices de l’industrie pharmaceutique sont rarement les fruits d’énormes dépense de Recherche Développement, telles que tout un chacun imagine lorsqu’il réfléchit au monde du médicament.
En effet, on apprend que la majorité des frais de recherche sont supportés par les États soit par le financement direct de laboratoires publics, soit par le subventionnement de laboratoires privés.
Pire, des découvertes publiques sont par la suite privatisées sans bénéfice pour les États financeurs.
De plus, bien que grands pourvoyeurs de fonds, les États ne peuvent ni orienter les recherches (vers des maladies rares par exemple), ni influer sur les prix de vente…
L’État finance alors une fois de plus l’industrie via la Sécurité Sociale.
Les traitements ont leurs prix librement fixés par les industriels qui savent pertinemment que peu important le prix, les malades pourront se les offrir « grâce » à l’assurance maladie.
Le lecteur, citoyen et contribuable sort choqué de cette lecture très intéressante.
Il en ressort l’idée qu’il serait plus rapide que la recherche, la production et la vente de produits pharmaceutiques soit un marché étatique puisque les états interviennent à tous les maillons de la chaîne de cette industrie et que les profits considérables liés à ce marché servent assez peu les intérêts des premiers intéressés : les malades.
Parution le 1er septembre 2022
chez 10/18, collection Amorce
112 pages / 6€
Daddy, Emma Cline, 10/18

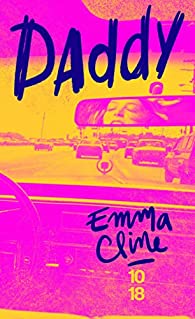
Daddy est un recueil de nouvelles qui dresse un état des lieux d’une certaine Amérique.
Les histoires sont variées ; il est difficile de voir un lien entre elles.
Pour de plus amples informations sur la nature des intrigues, je vous invite à lire la quatrième de couverture.
Le titre pourrait faire penser que le lien entre les nouvelles serait la paternité.
En effet, dans la majorité des cas les histoires sont centrées sur un père.
Elles sont surtout toutes centrées sur des personnes en plein désarroi, en plein doute.
Les protagonistes sont souvent tristes, mélancoliques, perclus de regrets et parfois sujet à des addictions.
De par cette variété d’histoires, il est difficile de chroniquer un recueil de nouvelles.
Les différentes nouvelles ne sont pas reliées par une unité de temps, de lieu ou de milieu.
Le système de narration en revanche est identique pour chacun des récits : Le narrateur entre dans le vif du sujet sans introduction ; comme si le lecteur entrait dans une pièce sans faire de bruit et constatait la scène.
Effectivement, chaque nouvelle représente une scène « théâtrale » ; charge au lecteur de tirer ses propres conclusions sur les personnages, les liens entre eux, la raison pour laquelle ils sont présents sur scène.
Durant quelques pages, la scène se déroule et très vite le rideau tombe sans qu’il y ait de conclusion ou de morale.
Pas d’avant, pas d’après…
Le lecteur est quelque peu décontenancé par chaque fin de nouvelle ; ce sentiment n’invite pas à se lancer dans la suivante sans attendre.
A dire vrai, certaines nouvelles m’ont laissé perplexe, voire perdu.
Si je n’avais pas eu ces mots à taper, je serais peut-être directement passé à un autre livre.
Parution le 15 septembre 2022
chez 10/18
Jean Esch (traduit par)
264 pages / 7,90€
C’est un métier d’homme, Oulipo, David Migeot, Denis Fouquereau


L’Oulipo* nous propose une série de monologues écrits sur le même canevas, autoportraits absurdes d’hommes se définissant par leur métier, réels ou imaginaires : descendeur de montagne (ou de bouteille), séducteur, écrivain, messie, féministe, tyran, psychanalyste, terminateur de spectacle…
Le canevas commence par : « Mon métier consiste à », déroule une définition subjective reposant sur des exemples concrets, évoque le sommet supposé de l’art de l’homme du métier avant d’aborder sa chute, le faux pas qui le décrédibilise définitivement, la honte qui l’expulse loin de ses pairs.
Les deux interprètes David Migeot et Denis Fouquereau, qui ont aussi participé à l’écriture des portraits, ont créé le spectacle en 2013 et leur duo comique semble effectivement soudé, complice et efficace. Physiquement, Davis Migeot endosse aisément le rôle du séducteur (sûr de lui) et/ou de l’écrivain (pédant), tandis que Denis Fouquereau assume de longs silences, les yeux ronds, les pieds ballants, dans le rôle du psychanalyste, l’expérience du clown aidant.
La mise en scène permet d’éviter l’ennui que pourrait entraîner le côté répétitif du système d’écriture. En effet, la pièce commence comme une conférence où les présentations alternent, puis passe dans des genres différents, usant notamment de la vidéo : le spectateur assiste à l’enregistrement d’une émission littéraire télévisée, ou à la messe, ou à un cours de maths légèrement hystérique.
Les auteurs, habitués du Rond-point, Hervé Le Tellier, Clémentine Mélois, Michèle Audin, Paul Fournel, Jacques Jouet et Ian Monk inventent une forme singulière et signent un spectacle cocasse et divertissant. Le public est conquis.
Allez découvrir ce duo burlesque et ce texte collectif au Théâtre du Rond-Point, du 15 novembre au 4 décembre 2022.
* Les membres de l’Oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle (au début une dizaine d’écrivains et de mathématiciens réunis en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lionnais), s’inventent des contraintes pour atteindre une fantaisie poétique illimitée.
Jusqu'au 04 décembre 2022
Au Théâtre du Rond-Point, Paris VIII
Texte : L'Oulipo
Par David Migeot et Denis Fouquereau
Direction artistique : Hervé Le Tellier
Conception et interprétation : David Migeot, Denis Fouquereau
American Predator, Maureen Callahan, 10/18

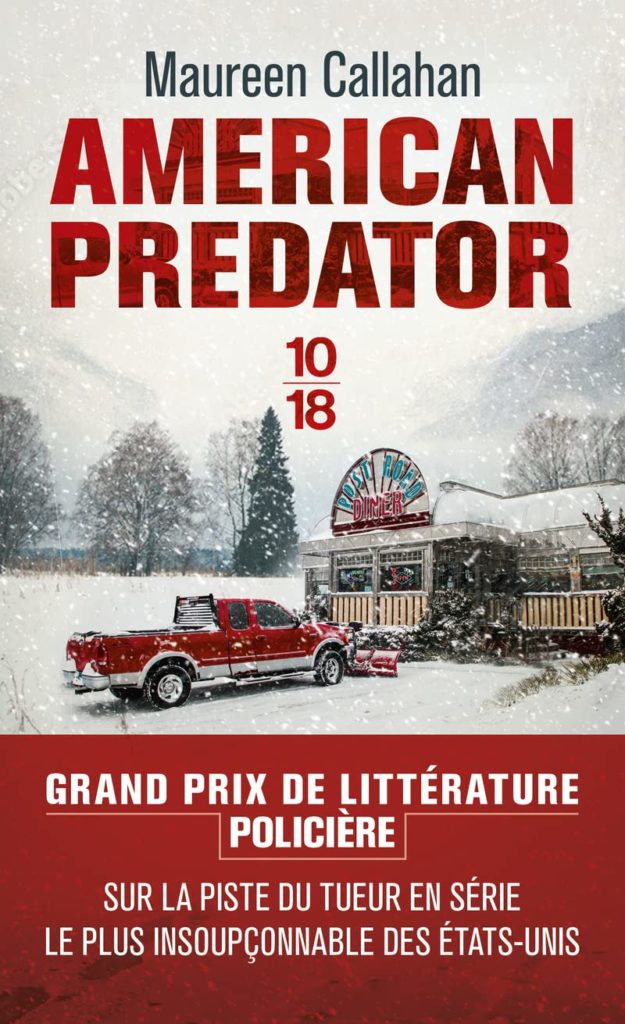
La journaliste d'investigation Maureen Callahan signe un livre sur le tueur en série américain Israël Keyes. Cette enquête qui se lit comme un (bon) roman est aussi passionnante que glaçante. Ce livre remarquable se lit d'une traite !
En février 2012, à Anchorage (Alaska), disparait une jeune femme qui travaille dans une minuscule cafétéria de bord de route. Au départ, la police pense à une banale fugue...
A cette erreur d'appréciation s'ajoutent - comme c'est souvent dans les faits divers états-uniens - des querelles de chapelles entre les différents corps de police impliqués (FBI, Criminelle locale, police de la route…). Tout cela sans compter ce Procureur à l'égo démesuré qui abuse de son pouvoir pour mener lui-même les interrogatoires du suspect, au risque d'invalider toute la procédure.
En dépit de ces vicissitudes, Maureen Callahan rend un hommage sensible aux flics de toutes sortes qui se prennent cette affaire traumatisante en pleine poire. Car il y a des perles d'humanité dans cette histoire, comme ce plongeur du FBI dont la vie consiste à côtoyer les morts, comme cette enquêtrice qui n'aime rien tant que décortiquer des données pour en faire émerger un récit, ou encore comme ce brave Texas Ranger qui arrive à tirer quelque chose d'un avis de recherche particulièrement flou et imprécis, ce qui mènera à l'arrestation d'un suspect. Une interpellation qui tient à peu près du miracle.
Alors qu'ils pensent avoir bouclé une "simple" affaire de kidnapping, les flics comprennent qu'ils n'en sont en réalité qu'aux prémices d'une enquête vertigineuse sur les agissements d'un tueur en série méthodique et impitoyable.
Un tueur assez cynique pour poser des "congés décès" lorsqu'il part en randonnée meurtrière, et assez froid pour assister tranquillement à une réunion parents-profs à l'école de sa fille... alors qu'il vient tout juste de se débarrasser d'un cadavre ! (page 173)
Israël Keyes n'est pas un tueur de masse du genre bourrin. Au contraire, ce type méticuleux, documenté et ingénieux déroute même les meilleurs profilers du FBI. Ayant étudié les biographies d'autres tueurs, il s'en inspire pour mieux brouiller les pistes et faire disparaitre les preuves. Doté d'une mémoire d'éléphant, il se souvient précisément de chacun de ses crimes, mais ne livre que ce qu'il veut.
Comme les livres de Tara Westover ou de Mikal Gilmore, le récit proposé par Maureen Callahan illustre tout le poids que la religiosité des parents peut avoir sur leurs enfants. Sans chercher d'excuses à Israël Keyes, on perçoit qu'il n'a pas été aidé par l'éducation que lui ont donnée ses parents, eux-mêmes assez mal barrés et passés du mormonisme au suprémacisme blanc.
" Paradoxalement, ce sont ces actes qui lui permettent de se prendre pour le Dieu en lequel il ne croit pas." (page 249)
Heureusement, le talent et la rigueur journalistique de l'autrice rendent l'enquête fascinante et nous permettent de supporter la description des faits indicibles commis par ce grand manipulateur qui aime jouer avec les nerfs des enquêteurs comme avec ceux de ses victimes.
Parution le 03 novembre 2022
chez 10/18,
384 pages / 8,50€
Traduit de l'anglais par Corinne Daniellot
Prix de littérature policière 2022 - Grand prix - Étrangère
Bruce Springsteen, Only the strong survive
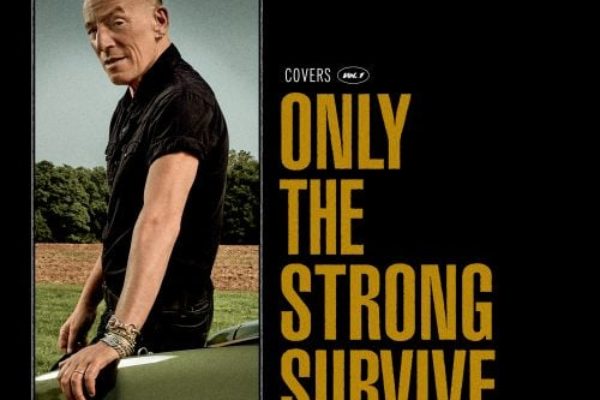

Bruce Springsteen sort un disque de reprises. Juste avant les fêtes de fin d’année. Comme par hasard, le boss met son plus beau costard cintré et se prend pour un chanteur de soul des années 50. Il est venu avec des beaux violons coulants et les cuivres de son mythique groupe le E Street Band. Ça pourrait être un disque de Noël.
Il reprend donc les titres de son adolescence. Il se plie aux règles du genre. Il se prend pour un malicieux crooner. A 73 ans, avant de reprendre la route pour une immense tournée, Bruce Springsteen semble se laisser aller… et vous savez quoi, ça fonctionne à merveille.
Depuis quelques temps, les albums étaient anecdotiques et cet album de reprises ressemble d’abord à un véritable disque de Bruce Springsteen. Le style est plus velouté évidemment mais les nappes de synthés et la voix du boss trouvent leur place dans des morceaux soul et rétro. Springsteen semble jubiler à reprendre ses classiques rien qu’à lui.
L’exercice de l’album de reprises est souvent jugé comme un effort plus commercial qu’autre chose mais ici, on ressent à chaque refrain un vrai plaisir de jouer et faire découvrir des morceaux incroyables. Le tout est conforté par des arrangements soignés. Bien souvent, ces chansons parlent de premier amour et on devine qu’il s’agit de ça dans cet album hors du temps.
Seul le fort survit ! Le boss le prouve une fois de plus en réussissant brillamment un exercice peu aimé des mélomanes et des fans. D’ailleurs profitons de cette chronique pour saluer deux albums mal aimés du boss qui pourtant avec le temps, distillent un certain charme.
Évidemment il s’agit de l’album Human Touch en 1992. Sorti avec un autre disque du boss, Lucky Town, Human Touch fut un succès commercial mais tout le monde en voulait au boss d’avoir mis de coté le E Street Band.
Pourtant le disque est de très bonne facture. Le soleil californien brille dans ce disque. Cela change du New Jersey mais ça n’empêche pas le boss de parler de sa petite Amérique, celle qui fait sa gloire, son succès et son inspiration.
On voit bien que notre boss n’est plus au sommet du rock’n’roll. Le Grunge vient grattouiller le vernis des productions des années 80. Metallica rend le metal commercial et les Guns font du grabuge sur le reste du Monde. Alors, aujourd’hui, écouter Human Touch c’est un peu écouter un échantillon de la formule Springsteen.
Il y a du rock et de l’introspection. Il y a de la tendresse et du muscle. Il y a des synthés et des guitares. Il y a un homme qui visiblement est très heureux de chanter. On est sérieusement dans le cliché springsteenien. Le chanteur se rassure comme il peut en recomposant son destin artistique (les meilleurs disques sont passés, on peut le dire désormais). Tout semble un peu forcé dans ce disque, qui se révèle extrêmement attachant au fil des écoutes et des années.
L’artiste est nettement plus révolté en 2012, sur Wrecking Ball, un effort balaise dans sa carrière. Il ne faut s’étonner d’y croiser son nouvel ami, Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine. Après la disparition du saxophoniste Clarence Clemons, le boss fonctionne à la colère et l’énervement. Ce disque est abordable en surface mais le ton est monté, ce qui a déplu à certains.
Le disque ne renie jamais cette hargne et en fait son énergie. Qui part un peu dans tous les sens. On trouve des notes hip hop à côté d’un folklore irlandais. Une fois de plus, Springsteen gronde pour tout le monde et la diversité américaine. Il cogne sur le gouvernement et Wall Street. Comme Born in the USA, on pourrait confondre son humanisme avec un certain nationalisme.
Comme tout disque de Springsteen, il faut y revenir de temps en temps. Comme Human Touch, il y a une sensibilité nerveuse qui fait la différence au fil du temps. Du temps, le boss n’en a plus tant que ça et réalise aujourd’hui son rêve de gosse : être un chanteur de soul ! Quelle bonne idée : son disque est sûrement l’un des meilleurs de cette année !
Arnaud Adami, Espace Richaud Versailles


Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir la belle exposition de peintures d'Arnaud Adami, à l'Espace Richaud de Versailles. Ne la manquez pas ! (L'entrée est libre, vous n'avez vraiment aucune excuse.)
S'il n'a pas encore terminé son parcours académique - Arnaud Adami est actuellement étudiant aux Beaux-Arts de Paris - le jeune homme de 27 ans fait déjà preuve d'une impressionnante maîtrise des techniques picturales. La filiation avec la peinture classique est assumée, si ce n'est revendiquée. Dans ses œuvres, Arnaud Adami rend hommage aux Primitifs italiens comme aux peintres de la Renaissance. Un réalisme tel qu'on pourrait presque se croire devant des photographies.
De la peinture figurative ? C'est du déjà vu me direz-vous, c'est ringard, pour ne pas dire kitsch.
Pourtant, Arnaud Adami est bel et bien moderne. Sa peinture est en prise directe avec le réel de notre époque. Les thèmes abordés sont résolument modernes. L'artiste portraiture les forçats de notre Société : les livreurs, les soignants, les ouvriers d'abattoirs, ces premiers de corvée qu'on a oubliés à peine passée la crise Covid. Il les peint avec précision et respect. Avec lui, vous ne serez pas étonné qu'un livreur se transforme en prince.
Le travail d'Arnaud Adami m'évoqué les « Raboteurs de parquet » de Gustave Caillebotte. Quant à son portrait d'un réanimateur du SMUR en train d'intuber un patient, il m'a fait penser au portrait de Louis Pasteur, du peintre Albert Edelfelt que j'aime tant.
De sacrés références pour un jeune peintre prometteur !
Jusqu'au 20 novembre 2022
Espace Richaud, Versailles
http://arnaudadami.fr/
Entrée libre
Ezra Collective, Loyle Carner, Kokoroko : le vent chaud de London !

Le mois de novembre amène bien souvent son lot d’idées noires qui s’évaporent dans des vents gris et frais. Ce n’est pas la joie, le mois de novembre. Heureusement il existe une solution pour lutter contre la morne humeur : l’enthousiasme.

Écouter et entendre de l’enthousiasme, ça fait un bien fou. On peut trouver cela dans les concerts. On peut aussi découvrir cela dans les disques qui viennent nous surprendre. C’est le cas d’Ezra Collective par exemple qui revient avec l’album Where I’m meant to Be.
Un groupe qui mêle les styles en partant d’une base jazzy. Mais ils dépassent tous les genres avec une fougue surprenante pour une formation londonienne. Quand on écoute leur musique, on n’entend pas Big Ben mais une ouverture énorme sur les autres musiques.
Multiculturel, leur jazz mange à tous les râteliers mais a surtout une féroce faim. Il a envie de nous faire danser et c’est beaucoup. Réellement il s’agit d’une musique joyeuse, urbaine et sans limite. Un vrai bonheur à découvrir quand il pleut dehors !

Ils ont d’ailleurs déjà croisé le chemin de l’excellent rappeur anglais Loyle Carner, qui sort ces jours ci son troisième album. Aussi pertinent et agréable que les autres. L’accent est typiquement british mais le flow est incroyable, accessible et fascinant.
Il n’a pas besoin de gonfler les muscles pour nous impressionner avec ce sens de la mélodie assez unique dans le genre. On a clairement à faire à un mélomane et c’est beaucoup. On dépasse le stade du beat pour de véritables chansons, qui piochent dans la culture urbaine, le gospel et même le rock.
Le gars est cool mais pas nonchalant. Tout est maîtrisé dans cet album aux sons travaillés. Il ne s’attarde pas pour sa démonstration. En une trentaine de minutes, il fait le tour de la question rap contemporain. Répond avec une virtuosité lyrique. Droit dans son style, Loyle Carner confirme qu’il est bien un artiste important et son nouvel album donne un élan incroyable à se promener dans les brumes du mois de novembre.

Autre groupe de la capitale anglaise, Kokoroko fabrique dans les clubs de la ville, une musique ensoleillée et qui réchauffe durablement. Could we Be More est une couverture chauffante qui vous prépare aux jours meilleurs..
Le groupe est composé de musiciens venus d’univers différents. C’est ce qui fera la richesse de cet album fait de soutien et d’entente. Mieux qu’une publicité des années 80 pour la marque italienne Benetton.
Pour résumer simplement, on pourrait parler de jazz afro caribéen mais c’est un peu plus que ça tant les musiciens savent se servir de palpitantes nuances. C’est moderne et traditionnel. Ça ressuscite les vieux beats d’antan et le collectif ne s’interdit aucune idée courageuse. On tient là une des pépites de l’année. Le nom du groupe veut dire Sois fort ! Ce disque est impressionnant.
Tous ces groupes venus de Londres ont su trouver la solution pour contrer les tristes moments de novembre. Les Anglais, en matière de déprime, sociale, économique ou morale, ont pris des coups cette année ; leur musique semble être un excellent remède et un élan nécessaire.
Je t’embrasse de toute ma ferveur révolutionnaire, Ernesto Che Guevara, 10/18


Ce petit livre bien rouge comme il faut est une sorte d'exposition surprenante sur le révolutionnaire devenu symbole d'un communisme guerrier et un poil excessif.
C'est ce qu'on aime dans son courrier. Le jeune homme de 18 ans est d'un enthousiasme renversant. Les voyages forment la jeunesse : ils fabriquent ici un homme en colère et un médecin qui décide de soigner la politique par les armes et la guérilla.
Le livre est soigneusement chapitré. La famille. Le combat. La politique. Les doutes. Tout y passe avec une verve incroyable. Il faut piocher dans ce courrier : le ton est différent selon le correspondant. Tout lire à la suite ne serait peut-être pas savoureux ; il faut faire comme lui : se porter vers la curiosité et l'inconnu.
Il a le ton solennel. Il a la confidence familiale. Le Che est découvert par tous ses écrits, souvent rédigés à la hâte. Le voyage curieux d'abord, puis dans les jungles et les combats.
En tout cas, on admire l'homme sincère. Il s'amuse autour de ses faiblesses (amoureuses) et passe en surchauffe dès qu'on entre dans le domaine de la politique. Mais le livre rend hommage surtout à l'écriture et son importance dans l'existence.
Faire le récit de sa vie. Au-delà de l'ego, Ernesto Che Guevara rappelle que cet effort a bel et bien quelque chose de vital (du moins au 20ème siècle), surtout quand la vie est tumultueuse comme celle de ce révolutionnaire forcené. L'intimité du personnage est multiple et on s'étonne des tons employés, différents et radicaux.
Parution le 03 novembre 2022
chez 10/18, Littérature étrangère
Éditeur originel Au diable vauvert
Antoine Martin (traduction)
504 pages / 10,50€
La Cerisaie, Anton Tchekhov, Clément Hervieu-Léger, Comédie Française


La Cerisaie, « comédie en quatre actes », écrivait Tchekhov : une comédie au goût très amer, car c’est un pari fou d’espérer faire rire avec des personnages nostalgiques ou dérangés et une action qu’on pourrait résumer à une expulsion pour dettes !
La Cerisaie, dernière pièce de Tchekhov, pièce « testament », créée par Stanislavski et le Théâtre d’Art de Moscou en 1904 ; montée pour la première fois en France par Jean-Louis Barrault en 1954, dans la traduction d'Elsa Triolet, La Cerisaie est ici mise en scène par le sociétaire de la Comédie française Clément Hervieu-Léger, dans la traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan.
Comme dans toutes les pièces de Tchekhov, l’action se situe dans le milieu de la petite noblesse désargenté, dans la campagne russe, au tournant du XIX et du XXèmes siècles.
De retour de Paris, en pleine nuit, après cinq ans d’absence, la noble Lioubov retrouve la maison de son enfance : une grande maison dans une immense cerisaie en fleurs (nous sommes au mois de mai). Elle est accompagnée de sa plus jeune fille Ania, qui était partie la chercher, de Charlotta, sa préceptrice, et d'Yacha, son valet de chambre ; éreintés et émus, ils sont accueillis par Varia, la fille adoptive de Lioubov qui dirige le domaine, l’oncle Gaïev, le voisin désargenté Pichtchik, Firs, le vieux valet de chambre de la famille, Trofimov, étudiant et ancien précepteur du fils de Lioubov et Lopakhine, homme d’affaires. L’atmosphère de leurs retrouvailles est d’autant plus fébrile que la propriété doit être vendue aux enchères au mois d’août, pour dettes. Lopakhine leur rappelle cette réalité et leur donne même une piste pour « rentabiliser » le domaine : le démanteler en parcelles et construire des datchas, des maisons de vacances, à louer aux premiers estivants. Malin… au premier acte, on ne lui répond carrément pas ; au second acte, on lui rétorque que cette idée est très vulgaire ; au troisième acte seulement on s’inquiète de l’issue des enchères ; au quatrième acte, les bagages sont faits : tout le monde est expulsé ! Décidément, l’histoire avance (« le temps passe »1) un peu trop vite pour certains. Lopakhine ne cesse de presser tout ce petit monde vers la sortie, leur rappelant d’abord la date des enchères puis l’horaire du train qu’ils ne doivent pas louper… Serait-ce du déni devant la catastrophe qui s’annonce (qui n’est pas sans rappeler la sidération et le déni climatique) ou la persistance de vieilles habitudes (le jeu, l’oisiveté) ? En tout cas, il y a un ancien monde qui ne veut pas mourir, et un nouveau monde pressé d’apparaître.
Pour remettre l’œuvre dans son contexte : Tchekhov est né en 1860 et mort en 1904 (quelques mois avant la révolution russe) et le servage en Russie a été aboli en 1861. Son père et ses grands-parents étaient d’anciens serfs. L’action dans son théâtre se situe toujours entre deux époques. Lui-même a connu une enfance très pauvre, le commerce de ses parents ayant fait faillite, ses frères et lui ont dû subvenir aux besoins de la famille alors qu’ils étaient encore étudiants (Anton, en médecine). Grâce aux éditions de ses articles et nouvelles, il a fait construire une maison pour sa famille (l’exercice de la médecine ne lui rapportant que peu de revenus). Il a vu une certaine noblesse perdre son pouvoir et d’anciens serfs devenir hommes d’affaires. Il a été sensible aux bouleversements et aux injustices de son temps (voir son voyage dans l’Extrême-Orient russe et son témoignage du bagne dans son essai L'Île de Sakhaline).
Dans la Cerisaie, l’ancien monde est celui des nobles Lioubov et son frère, qui sont restés deux grands enfants, assistés, dépensant sans compter « On prétend que toute ma fortune est partie en bonbons ! 2 », joueurs, inconséquents (« Je n’ai jamais rencontré de gens aussi légers, aussi peu pratiques, aussi étranges que vous ! 3 »), et leurs domestiques, puisque ceux-ci doivent se replacer ou mourir, quand les maîtres sont expulsés.
Le nouveau monde c’est celui des travailleurs indépendants (Varia), des hommes d’affaires (Lopakhine achète les terres de Lioubov, des Anglais exploitent le sous-sol de Pichtchik), du chemin de fer et de l’adaptabilité aux lois du marché. Il faut travailler, gagner sa vie, vendre ou louer, démanteler l’ancien pour offrir du nouveau.
Tout au long des quatre actes, Pichtchik quémande des prêts, en se plaignant du fardeau de ses dettes, un passant mendie quelques roubles, Lioubov emprunte de l’argent à Lopakhine qu’elle distribue aux moujiks, Varia qui gère la cuisine, traque le gaspillage et chasse les pique-assiettes, bref : tout tourne autour de l’argent. Étrangement moderne cette vision des relations humaines sous l’angle économique. A la même époque, Claudel écrit sa pièce L’Échange 4…
A propos de modernité, je trouve quand-même incroyable que le sujet de cette pièce soit une cerisaie, un espace naturel menacé de destruction, qu’on voudrait dédier au tourisme, c’est-à-dire aux loisirs… à se demander si, dans une certaine actualisation, le lieu de l’action ne serait pas aujourd’hui (cela semble évident) une Zone A Défendre ? Notre-Dame-des-Landes, Bure en Moselle, la Cerisaie, même combat ? Dans ses didascalies, Tchekhov avait prévu qu’à la fin, après le départ de tous les protagonistes, après le monologue de Firs, qui marmonne et s’allonge seul (faisant là étrangement penser à la modernité de Beckett), des coups de hache résonneraient seuls : « on n’entend plus que des coups de hache contre les troncs d’arbre, loin dans le jardin. »
Heureusement, il y a aussi, dans ce texte, dans cette histoire implacable, de la place pour l’incertitude, pour le sentiment amoureux et pour la philosophie. Les personnages (les plus jeunes en tout cas) se cherchent et s’interrogent. Difficile de dire ce qui prime : l’abattement ou l’enthousiasme ? La nostalgie ou l’espoir en un monde plus juste et plus beau ? Si le mariage dont tout le monde parle ne se conclut pas, une autre union plus inattendue se révèle. On balance en effet d’une émotion à l’autre, balloté d’une lame de fond à l’autre, de la comédie au drame.
A voir sans hésiter, pour découvrir ou redécouvrir Tchekhov, pour apprécier le talent d’acteurs chevronnés, pour se laisser porter par leur intelligence du texte, ses enjeux et ses mystères.
1 Lopakhine, acte I.
2 Gaïev, acte II, en plaisantant.
3 Lopakhine, acte II, s’adressant à Lioubov et à Gaïev.
4 Une première version de l’Echange date de 1894, une seconde de 1951. La seconde version est créée au Théâtre Marigny par la Compagnie Renaud-Barrault en 1951 (cette même compagnie créé La Cerisaie en 1954).
Jusqu'au 30 janvier 2023
La Cerisaie d’Anton Tchekhov - traduction André Markowicz et Françoise Morvan - mise en scène Clément Hervieu-Léger - avec la troupe de la Comédie-Française (Florence Viala, Eric Génovèse, Loïc Corbery, Michel Favory, Julie Sicard…) - Salle Richelieu, Comédie française, création 2021, reprise du 31/10/2022 au 30/01/2023.
Apprendre à se noyer, Jeremy Robert Johnson, 10/18
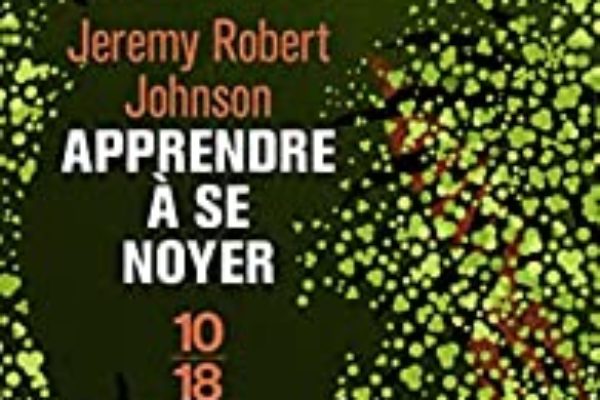
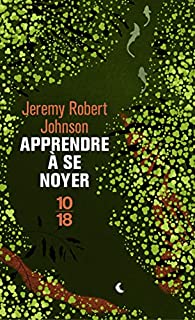
Bienvenue dans l’enfer vert! En 142 pages, le romancier Jeremy Robert Johnson nous entraîne dans un sinueux voyage mystique qui ne laisse pas indifférent.
Car le titre de la courte nouvelle résume assez parfaitement le style : apprendre à se noyer. Faire face à la douleur. Comprendre ce qui n’est pas compréhensible. L’humain face à la nature. Un père qui craint pour son fils. Des créatures qui décident de se prendre pour un destin…
Johnson ira de toute façon à l’essentiel. Son livre est d’un minimalisme qui finit par nous cogner très fort. C’est une littérature qui percute. Comme dans une rivière sauvage. Le lieu où va commencer le drame d’un homme qui perd son fils dans une dense nature. Il court vers l’inconnu pour retrouver sa descendance, mordu par une bestiole aquatique…
La sécheresse de ton n’empêche pas de toucher l’humanité. Rien de plus cruel que la disparition d’un enfant. Mais le voyage va virer vers un mysticisme assez fascinant. Les mots et la mise en page vont nous faire entrer dans l’esprit torturé du héros, mis en scène avec une énergie due au désespoir.
L’auteur est responsable d’un autre roman devenu culte, Skullcrack City ; Apprendre à se noyer continue de tracer cette route littéraire où la nature révèle bel et bien les pulsions de chacun. Les vertueuses comme les mauvaises.
L’aspect épuré de l’écriture, la singularité du conte, les démons qui se cachent dans la nature, le livre décrit une jungle aussi mystérieuse qu'inquiétante. Une vision primitive ou primaire de l’humanité. L’homme rentre peu à peu dans un chemin de violence puis de mort.
Cependant c’est intense et beau. Il y a une grâce dans ce paysage dangereux, vert et poisseux. On devine l’humidité se mêler à la transpiration. On finit par comprendre ce triste père perdu dans un grand nulle part. Sauvage et beau!
Paru le 20 octobre 2022
chez 10/18
Jeremy Robert Johnson
Jean-Yves Cotté (traduit par)
142 pages / 6,60€




