La Croisière du Hachich

 Le GPS n’existait pas encore, quelques morceaux de terre restaient à découvrir, l’âge d’or des aventuriers touchait à sa fin. Et vogue Henry de Monfreid !
Le GPS n’existait pas encore, quelques morceaux de terre restaient à découvrir, l’âge d’or des aventuriers touchait à sa fin. Et vogue Henry de Monfreid !
Sa relecture est toujours rafraîchissante en période de rentrée littéraire et de refrain connu : trop d’autofiction, de nombrilisme étroit, de parisianisme germano-pratin… Assez ! De l’air… Eh bien, en voici justement, de l’air, et même du grand air, plein les pages de ce livre, initialement publié en 1933.
Pour décrire l’activité de Monfreid au début du siècle dernier, qu’il raconte dans ses récits autobiographiques, il faudrait inventer le verbe "contrebander". C’est plutôt viril, mais la contrebande se conjugue le plus souvent au masculin. Monfreid contrebande donc de long en large, en dilettante des commerces interdits et en futur écrivain. Il contrebande au gré de ses humeurs et de ses fortunes, à droite et à gauche - pardon, à tribord et à bâbord.
Au bout des comptes, quelle forme de contrebande n’a-t-il pas pratiquée ? Dans La Croisière du hachich, disponible depuis quelques années dans un recueil de six récit intitulé Mer rouge, il trafique une nouvelle fois entre Egypte et Arabie, après être allé négocier et acheter une cargaison de hachich en Grèce. L’audace, la chance et l’inconscience du novice lui permettront de mener à bien son entreprise.
Au passage, il dresse les portraits, parfois chargés, d’une galerie haute en couleurs : seigneurs de la contrebande, policiers corrompus, diplomates avilis, etc. On se demande bien de temps en temps ce qui est authentique, ce qui ne l’est pas, mais à quoi bon ? Tous les raconteurs sont un peu mythomanes… La question s’évapore au soleil, on sent le sel sur sa peau, on y est, c’est tout ce qui compte.
Mais Monfreid n’est pas seulement un aventurier du début du vingtième siècle. Ce qui le distingue, c’est d’abord qu’il écrit lui-même son histoire, et ensuite qu’il le fait en vrai poète, tous les sens en éveil. En poète, mais aussi en marin : à bord de son navire, le Fat el-Rahman, tout sonne juste, le lecteur embarque à la manœuvre avec le reste de l’équipage.
Tout sonne d’ailleurs tellement juste qu’on se trouve parfois largué dans les pages du dictionnaire, par tel ou tel nom d’espèce de poisson, rare sous nos latitudes. On part à la pêche aux définitions. Exemple : les pêcheurs de "trépang" nous amènent à "tripang", de là nous dérivons vers "holothurie", puis nous accostons à "échinoderme", etc. La pêche des "trocas", elle, laisse muet le Petit Larousse, illustré ou pas. Rien de trop long toutefois, ni de gratuit : on n’est pas dans une page d’histoire naturelle de Vingt milles lieues sous les mers.
Aventurier, écrivain-voyageur tendance nomadisme et rencontre entre l’orient et l’occident, Monfreid ressemble à un croisement de Hemingway et de Loti. Un peu daté, comme le second, il dégage parfois un net parfum de paternalisme, ou de racisme : "On se sent toujours gêné devant un être humain captif, fût-il un nègre." (page 265) Le lecteur de 2014 se pince à la lecture d’une pareille phrase, mais manifestement, pour Monfreid, l’espèce humaine se compose de différentes races, comme l’espèce canine, mettons, avec chacune ses qualités et ses défauts - au crédit de l’auteur, les blancs ne valent pas mieux que les autres.
Avec cette vision des peuples, Monfreid pourrait être un écrivain de la différence, mais c’est surtout un écrivain de la rencontre - première étape de la globalisation, premiers acteurs depuis des siècles : les marchands sur leurs navires. Les écrivains du métissage, les Michel Serres, viendront plus tard.
237 pages - Grasset
Black Storm

Le mauvais temps est aussi sur les écrans. Arrêtez de vous plaindre: les apprentis cinéastes de Black Storm s'en prennent plein la gueule et ce n'est pas du crachat breton!
Il faut dire qu'ils le méritent ces idiots: ils sont chasseurs de tornades ou plutôt chasseurs d'images. Depuis Paranormal Activity, le found footage est à la mode et permet de justifier les plus belles âneries au cinéma. C'est surtout vrai dans le film d'horreur. C'est donc possible et valable avec le film catastrophe.
Le film montre donc des gars qui se filment en train de cadrer des cyclones et surtout des tornades qui rasent la campagne américaine. Donc un frère filme son père qui téléphone à son autre fils qui filme une fille qu'il aime bien dans une usine désaffectée et bientôt balayée par la tempête. Ils sont filmés et aidés à leur tour par des chasseurs de tornades pas bien rusés mais guidés par une chercheuse plutôt mignonne et botoxée. Ils ont des caméras tout partout. Enfin deux rednecks font les clowns et des blagues vaseuses autour du phénomène meurtrier avec une gopro!
Complice de James Cameron, Steve Quale est un solide technicien mais un gros naze en matière de réalisation. Son found footage n'est jamais crédible et assumée pour que toute son histoire soit limpide. Il multiplie mécaniquement les personnages, aussitôt envoyés en l'air par les tempêtes certes spectaculaires mais un peu répétitives.
Il suit donc trop sagement des pauvres types avec leurs caméras et leurs portables, faisant tout ce qu'il ne faut pas faire devant ce genre d'événements graves et dangereux. Evidemment on se moque d'eux et finalement on n'est pas mécontent de les voir passer à la moulinette! C'était le principe de Destination Finale, précédente réalisation de Steven Quale.
Caricatural dans sa forme, Black Storm empile les clichés avant d'être soufflés par l'extrême tornade. Quelques scènes décoiffent mais sinon le film déçoit. Twister à coté, c'est du Bergman!
Avec Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Max Deacon et Matt Walsh - Warner Bros - 13 aout 2014 - 1h30
If…

La beauté triste de If...est impressionnante. Avec le moral dans les baskets, ce disque pourrait tout de même vous rendre heureux.
Vous n'aimez pas la grisaille d'hiver ? Ca vous annule toute envie d'optimisme ? Ca vous mine le moral ? Vous avez le verre à moitié vide ? Vous êtes sinistre ? L'hiver vous abime et la morosité est la pire des maladies de cette saison ?
Alors, si vous tombez sur le disque de Bill Ryder Jones, ne le mettez pas sur votre platine ! Une très mauvaise idée si la tristesse rôde autour de vous. Car l'ancien guitariste de The Coral n'a pas réalisé un disque avec de la vitamine C ainsi que des idées rondes et chaudes !
Inspiré par un roman d'Italo Calvino, le guitariste ne va pas faire dans le rock vintage mais dans la musique classique avec un soupçon de pop. Une musique de chambre calme et sombre. Un ombrageux disque romantique.
Bizarrement on pense aux musiques de films de Darren Aronofski ("Requiem for a dream" ou "The Fountain") et à des ritournelles presque médiévales. Les références sont un peu austères. Elles révèlent une qualité d'écriture fascinante.
Bill Ryder Jones, copain d'Alex Turner (patron pointu des Artic Monkeys) et Graham Coxon (guitariste capricieux de Blur), apprécie les nuances et les harmonies. Son disque est une bande son, une musique originale d'un bouquin. Mais surtout il nous la propose avec une simplicité étonnante.
C'est d'un lyrisme inattendu. L'orchestre a de l'énergie à revendre sans en mettre plein les oreilles. Au contraire, les parties chantées sont aussi rares qu'importantes. Elles accrochent un peu plus notre attention puis notre affection.
Bien entendu, ce n'est pas joyeux. On utilise souvent le mot mélancolique pour décrire de la musique. Ici, c'est l'adjectif idéal. C'est lancinant, introspectif et triste. Pourtant l'éclat est lumineux. La lumière est rasante mais sensationnel : ce disque fait vibrer.
Les suspensions et les hésitations suggérés par le titre de l'album sont les secret de la grande réussite de ce disque élégiaque, d'un autre temps, où il ne faut pas lutter contre l'atermoiement: il est la plus belle source d'inspiration !
Dead Man Down

Franchement, un film avec Isabelle Huppert, produit par la fédération de catch américain, qui raconte une sombre histoire de vengeance, c'est le dvd idéal pour l'été!
Il y a d'abord Colin Farrell. Bon acteur, il a souvent fait des choix maladroits et on ne s'étonne plus de le voir dans un nanar hollywoodien. Un truc bizarrement fait en réalité: c'est la WWE, la fameuse fédération de catch qui produit. C'est le réalisateur danois de Millenium, version suédoise, qui s'installe derrière la caméra. Le casting réunit la subtile Noomi Rapace, le magnétique Terrence Howard, le sympathique Dominic Cooper et les inusables Armand Assante ou F.Murray Abraham.
Y a du beau monde pour défendre un polar d'une simplicité déconcertante: une histoire de double vengeance avec un truand au coeur tendre et une fille défigurée (franchement à peine) qui veulent taper sur le maximum de méchants.
Peut être est ce l'influence du Catch qui fait la joie des jeunes téléspectateurs, mais aucun des comédiens ne peut s'empêcher de grogner. C'est assez rare pour être signalé: notre Isabelle Huppert cachetonne réellement dans Dead Man Down. Elle joue la mère un peu zinzin de la balafrée.
C'est un peu le concours de celui qui va le plus en faire pour ne plus être crédible. Au premier degré, le film affiche le lot suffisant et bien pesé de scènes d'action et de règlements de comptes plus ou moins sanglants. C'est plutôt ennuyeux.
Le réalisateur doit d'ailleurs certainement faire avec les techniciens des shows de catch. Les couleurs sont un peu cradingues et tout cela est assez vulgaire visuellement. Le fil m pourrait être jeter aux oubliettes. Mais ce casting rend la chose un peu baroque.
Peu crédible, le scénario permet aux comédiens les excès et les interprétations les plus libres. Tout est exagéré. L'histoire pourrait être intéressante mais la production ne fait pas du tout dans la nuance et propose un traitement bourrin (quand elle est triste,l'héroïne écoute du Zaz) , pataud, agaçant et parfois il faut le dire touchant. Parce que les acteurs se battent... désespérément... Contre le mauvais goût ou la faute de goût... leur combat est perdu d'avance! Dur loi du catch... et du nanar!
Décomposition

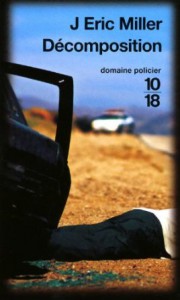 Une fille roule sur les autoroutes de la Nouvelle Orleans jusqu’à Seattle. Dans son coffre, le cadavre de son amant commence sacrément à puer. Vous reprendrez bien une tranche de gigot dominical ?
Une fille roule sur les autoroutes de la Nouvelle Orleans jusqu’à Seattle. Dans son coffre, le cadavre de son amant commence sacrément à puer. Vous reprendrez bien une tranche de gigot dominical ?
Un petit conseil pédagogique tout d’abord : ne lisez pas ce roman si vous vous apprêtez à manger ou si vous venez de le faire. Il vous couperait l’appétit ou vous gâcherait la digestion.
Cela étant posé pour votre confort personnel, venons-en à Décomposition, un roman de J. Eric Miller très bien traduit par Claro. Un roman dont le titre ne trompe pas sur la marchandise.
C’est l’histoire d’une jeune femme dont la beauté cache bien des félures. Elle vient de tuer Jack, un écrivain avec qui elle vivait depuis quelques mois. Elle l’a massacré, puis a déposé son cadavre dans le coffre de sa voiture. Et elle a pris la route avec ladite voiture pour retrouver un autre homme, George, qu’elle avait largué précédemment pour Jack… Vous suivez ?
Le roman raconte son périple, à la fois en voiture et dans la vie. Elle a tué Jack alors qu’ils vivaient à la Nouvelle Orleans et au moment ou l’ouragan Katrina ravage le ville. Cette fille qui nous parle, c’est un peu un ouragan à elle toute seule.
Ce roman, qu’il faut ranger dans la catégorie polar parce qu’il est édité par les Editions du Masque, est également un conte déjanté à la Lynch, mais aussi un récit initiatique. C’est également un précis médical de décomposition (on apprend tout sur le processus). Il a le culot de poser une bonne question : à partir du moment où on devient violent envers les autres, combien de temps faut-il avant de devenir violent envers soi-même.
Par ailleurs, ce roman dégraissé vous interdit de bailler. Il vous happe et vous tient sans vous lâcher. J. Eric Miller, dont on ne sait pas grand chose, a suivi les cours de creative writing de James Crumley, l’un des meilleurs écrivains américains qui vient de mourir après une vie de picole, de défonce et d’amour de la littérature.
J. Eric Miller a retenu la leçon et nous offre une version apocalyptique d’une Cendrillon on the road again. C’est assez répugnant et ça fait du bien par où ça passe.
204 pages - 10/18
Rock Bottom

Rock Bottom, une œuvre unique et intemporelle, d’une liberté musicale absolue et dont la connaissance de la genèse facilite son appréhension.
On peut traduire le titre par « le fond du fond », « toucher le fond ». Illustration en fonds sous-marins sur la pochette. Sea song, une des chansons les plus belles et les plus poignantes de l’histoire du rock. Rock Bottom, une œuvre unique et intemporelle, d’une liberté musicale absolue et dont la connaissance de la genèse facilite son appréhension. Tout et n’importe quoi ayant été dit sur le sujet depuis 1974, c’est la version de Robert Wyatt en personne (datant 1998) que nous vous avons choisi de vous retranscrire ci-dessous.
« Rock Bottom (curieuse histoire d’un morceau de musique)
Cette oeuvre a commencé à émerger à Venise, pendant l’hiver 1972, dans une imposante vieille bâtisse de la minuscule île de Giudecca donnant sur la lagune.
Pendant deux mois j’y ai passé mes journées tout seul, pendant qu’Alfie (NDLR :Alfreda Benge, sa compagne aujourd’hui encore) et un groupe d’amis travaillaient sur un film. Après des années d’activité incessante en groupes et en tournées (NDLR : R.W. était le fabuleux batteur de Soft Machine), j’avais du mal à rester à ne rien faire. Pour m’occuper, Alfie m’a acheté un petit clavier très simple, doté d’un singulier vibrato qui chatoyait comme cette eau qui nous entourait. C’est là que la structure de base de l’album a vu le jour, entre l’observation des lézards sur les murs de la maison et les visites au bar local à écouter les gondoliers désoeuvrés s’exercer au bel-canto.
Le scénario de « Don’t look now » (NDLR : « Ne vous retournez pas », d’après Daphné du Maurier, avec Julie Christie et Donald Sutherland), le film sur lequel mes amis travaillaient, tournait autour d’une série de catastrophes inattendues qui perturbent la vie d’un couple. Venise elle-même jouait un rôle sinistre dans le film. Alfie se souvient encore de Nicolas Roeg, le réalisateur, assénant inlassablement le thème du film : NOUS NE SOMMES PAS PREPARES.
De retour à Londres, au printemps 1973, j’ai commencé à composer un nouveau groupe pour enregistrer ce qui était prêt. J’ai continué à travailler les musiques et j’ai écrit les paroles de Alife, Sea Song et A last straw dans l’appartement d’Alfie, au 21ème étage d’un immeuble moderne sur Harrow Road. Cet immeuble a été démoli il y a quelques années. Risque sanitaire. Il était truffé d’amiante. Ainsi, l’endroit où nous avions vécu, où nous avions appris à nous connaître, est-il à présent un simple morceau de ciel. Il nous arrive souvent de jeter un œil vers là haut et d’imaginer nos fantomatiques jeunes silhouettes en suspension, non préparées pour ce qui devait leur arriver.
Le premier juin 1973, la veille de la première répétition avec le nouveau groupe, je suis tombé d’une fenêtre du 4ème étage, me brisant la colonne vertébrale. J’ai été admis au Stoke Mandeville Hospital pour huit mois. C’est là qu’on m’a sauvé la vie et qu’on m’a appris à vivre en chaise roulante.
Je suis resté trois mois allongé à plat sur le dos, à contempler le plafond dans un dortoir commun surréaliste, au milieu d’une vingtaine d’autres comme moi, dont les vies avaient basculé en l’espace d’une seconde ; victimes d’accidents de la route, d’accidents industriels, mauvaise réception au trampoline, fuite ratée au cours d’un cambriolage. Il nous fallait tous nous pencher sur notre futur.
Je m’étais fait à l’idée que je ne serais plus jamais batteur et que partir en tournée serait très compliqué. Ce n’était plus la peine que j’écrive de la musique pour un groupe ; il faudrait que je me focalise sur le travail en studio et que je chante davantage. Je pourrais toujours trouver des musiciens ponctuellement, au gré des besoins. Je n’avais pas besoin d’une formation identique pour tous les morceaux. La perte de mes jambes m’apportait finalement une nouvelle sorte de liberté.
Entre les visites, les opérations et la vie d’hôpital, j’ai commencé à envisager les morceaux que j’avais écrits sous un autre angle. Après les trois premiers mois, on m’a fourni ma chaise roulante et je suis tombé sur un vieux piano dans la salle des visites. J’ai séché aussi souvent que possible les activités thérapeutiques que l’on impose aux néo-paralysés (tir à l’arc, collage de mosaïque sur des bouteilles pour faire des lampes magiques) et me suis rabattu sur le piano, dès que la salle était libre, pour reprendre les chansons que j’avais commencées avec les lézards, au bord de la lagune de Venise.
Quand j’ai quitté l’hôpital, j’étais prêt à enregistrer, mais nous n’avions plus de logement. Une gentille amie, Delfina, nous a prêté une petite maison de campagne accessible aux chaises roulantes, dans le Wiltshire. C’est là, début 1974, que j’ai commencé les prises, dans le studio mobile de Virgin Records garé dans la pâture d’à côté, avec en fond sonore un âne qui brayait au lointain. Au printemps, nous avons trouvé une maison à Londres où j’ai arrangé les parties des autres musiciens qui ont été enregistrées et mixées au Manor Studio et chez CBS.
Le 26 juillet 1974 ( 21ème anniversaire de l’attaque de la Moncada, coup d’envoi de la révolution cubaine) c’était la sortie de Rock Bottom, je me mariais à Alfie et nous vécûmes heureux pour toujours.
Robert Wyatt (Copyright Robert Wyatt février 1998) "
Transformers l’age de l’extinction

Des robots, des bimbos et des explosions: Michael Bay est un génie de son époque, un maestro du blockbuster pour abrutis décérébrés, un gros beauf qui a le mérite de croire en ce qu'il fait!
Car au bout de quatre épisodes, il pourrait commencer à s'ennuyer à filmer des grosses machines qui se collent des bourre pifs et font exploser des grandes villes. Il pourrait bailler devant ses actrices choisies pour faire du placement de produits et montrer leurs silhouettes affolantes et aussi extra terrestres que les robots, stars du film!
Il pourrait aussi se dire que le scénario de chaque volet est toujours un peu court pour allonger une oeuvre qui dépasse largement les 2h30. Il a une solution: filmer des explosions et des blondes. Au bout de quatre films, il ne se lasse pas le réalisateur de Bad Boys ou Armageddon.
Donc, sans surprise, Des robots déguisés en voiture doivent de nouveau sauver la planète Terre, devenue un repère de fachos qui pourraient rappeler Bush et ses copains. Ils font dans la guerre préventive et se disent que les robots, pour pas nous embêter, il vaut mieux désormais les exterminer!
Heureusement, un père de famille inventeur (et très musclé c'est Mark Whalberg) et sa fille (la blonde en mini short) vont tout faire pour que les robots évitent le carnage. Mais ca ne se fera pas sans quelques explosions, beaucoup de placements de produits et des bavardages absurdes, filmés de travers et à toute vitesse, servis par des acteurs en roue libre (pas mal non?). La palme revient à Stanley Tucci, héroïque dans la cabotinage et juste génial!,
Dans cet épisode, il se passe un truc fou: l'action se déporte à Hong Kong, une petite nouveauté pour attaquer le marché chinois mais qui change un peu de nos habitudes et celle du cinéaste qui découvre un nouveau décor à détruire. C'est la seule chose qui change réellement
Autrement la volonté du cinéaste à se vautrer dans la beaufitude la plus totale, le patriotisme le plus éculé, reste assez passionnant. Depuis son premier film, il ne peut pas s'empêcher de trop en faire mais sans véritable second degré, une espèce de cinéma d'action totalement dégénéré, abandonné au style sans aucun fond. Le cynisme hollywoodien dans ce qu'il y a de plus spectaculaire... et de plus long... 2h45 de voitures et de bastons!
Le titre annonce l'extinction, mais la formule marche encore (plus de cent millions de recettes aux Etats Unis en un week end) et donc on devrait vous ressortir la même critique dans deux ans. A vérifier!
Avec Mark Whalberg, Stanley Tucci, Nicola Peltz et Sophia Myles - Paramount - 16 juillet 2014 - 2h45
My Generation

Remettons les pendules à l'heure et redécouvrons un des plus grands albums de l'histoire du rock...
Pourtant, comme bon nombre de disques enregistrés au début des années 60, My generation suit une recette bien connue. En effet, l'album compile les premiers 45 tours des Who, des reprises de rythm'blues que le groupe jouait sur scène, et quelques chansons originales jugées moins évidentes commercialement. Le tout étant enregistré en un temps record et financé en partie par le producteur Shel Talmy lui-même. Ce dernier détail peut expliquer les longs démêlés juridiques qui ont longtemps empêché la réédition du disque.
Les relations entre le producteur américain et les Who avaient pourtant bien commencé. Afin de mieux séduire Shel Talmy également producteur des premiers Kinks, Townshend avoue avoir volontairement structuré I can't explain, le premier single du groupe, sur le modèle des chansons de Ray Davies. Encore aujourd'hui, le morceau surprend par sa puissance. Même remarque pour My generation, hymne comparable au Satisfaction des Stones, et dans lequel les Who déploient toute leur fougue. A propos de My generation, on sait déjà tout sur l'origine des bégaiements de Daltrey, dont Bowie se souviendra pour Changes, mais on sait moins que John Entwistle a dû utiliser trois basses pour enregistrer son solo, les fragiles cordes de sa Danelectro étant introuvables. Citons également The kids are alright, condensé de tous les effets scéniques du groupe, l'entêtant The good's gone et l'excellent Circles.
Comme toujours avec les rééditions Deluxe, le travail sur le son est époustouflant ce qui nous permet d'entendre des petits détails amusants. Comme la discrète partie de piano sur I can't explain jouée par Perry Ford membre des Ivy League, groupe que l'on peut aussi entendre dans les chœurs. Mais c'est bien le jeu du jeune Keith Moon qui impressionne le plus. Les parties de batterie sont tout simplement exceptionnelles.
Deux ou trois petites choses sans importance ternissent tout de même cette réédition. La première est que le coffret offre une version alternative de Anyhow, anywhere, anyway sans que l'originale ne soit présente. Beaucoup plus gênant : en remixant l'album original en stéréo, les producteurs de cette édition Deluxe n'ont pu retrouver les prises de guitares réenregistrées par Townsend sur My generation et A legal matter, ce qui perturbe l'écoute du premier disque.
Mais bon, ce disque est quand même un incontournable pour votre discothèque !





