Le Lac des cygnes, Angelin Preljocaj, Chaillot


D’abord, une danseuse vient délicatement jouer avec une bulle de savon virtuelle. C’est très simple et très beau. Immédiatement l’émotion m’étreint : après de longs mois sans danse dans ma vie, je mesure à quel point cet art m’est précieux.
Malheureusement, la danse classique est trop souvent considérée comme intimidante, démodée voire un peu ridicule. Je comprends très bien qu’on puisse lui trouver un côté tarte à la crème rose-bonbon un peu indigeste (tutus, chaussons, pantomimes etc.). Mais avec Angelin Preljocaj, le ballet est dépoussiéré ; c’est, en somme, le parfait alliage entre la rigueur technique du ballet classique et la liberté de la danse contemporaine. Le Lac des cygnes proposé par ce chorégraphe de génie offrira une belle entrée en matière à ceux qui n’y connaissent encore rien. Ma fille de 7 ans, par exemple, n’a âs rechigné devant les presque deux heures du spectacle. Elle a apprécié la beauté des gestes, même si elle n’a pas toujours très bien compris l’histoire (qui est, il faut bien l’avouer, assez alambiquée).
Angelin Preljocaj transpose l’action du ballet à notre époque et, fidèle à l’air du temps, nous propose un Lac des cygnes teinté d’écologie, le tout assez lourdement appuyé par les vidéos. Pour résumer l’intrigue: à tout juste 18 ans, la mère du prince Siegfried (Clara Freschel qui réalise la performance de danser enceinte!) lui enjoint de trouver une épouse. Alors qu’il cherche le calme après une fête donnée en son honneur, il trouve l’amour au bord d’un lac en la personne d’Odette (Isabel García López), une ravissante princesse qui fut jadis métamorphosée en cygne blanc par le sorcier Rothbart (l'impeccable Antoine Dubois). L’horizon s’assombrit cependant bien vite. D’abord, le père de Siegfried (Baptiste Coissieu) autorise l’exploitation d’un gisement pétrolier sur le lac des cygnes, promettant celui-ci à la destruction. Ensuite, Rothbart et ses sbires battent le prince Siegfried qu’ils laissent pour mort. Enfin, parce qu’il tombe amoureux d’un cygne noir (sosie d’Odette envoyé par Rothbart), Siegfried condamne Odette à rester cygne (blanc) pour l’éternité.
Oscillant entre tradition et modernité, Preljocaj reste majoritairement fidèle à la musique de Tchaïkovski mais ne s’interdit pas quelques insertions de musique électro voire techno. Ainsi, lors de la fête d’anniversaire de Siegfried, danse et musique adoptent des rythmes jazzy pour se faire sensuelles. Puis, tout-à-coup, l’on se croirait dans West Side Story : l’explosion de couleurs et d’allégresse nous fait un bien fou et nous fournit quelques réserves de bonheur avant que le ballet ne sombre inéluctablement dans une noirceur désespérée (et aussi, il faut bien le dire, formellement moins intéressante).
Ce ballet n’est peut-être pas la meilleure chorégraphie de l’artiste (cf. le magnifique Blanche-Neige) ; mais tout de même, quel chorégraphe! La qualité des ensembles et l’exécution rigoureuse offerte par les membres du Ballet Preljocaj sont impressionnantes. Et il y a tant de choses magnifiques que l’on aimerait fixer dans sa mémoire : ce ballet millimétré des 25 danseurs qui se croisent mécaniquement sans se percuter, les corps relâchés dans une scène de boîte de nuit à la Grande Bellezza, les 16 cygnes en diagonale comme dans un paradis où les danseuses auraient avantageusement remplacé les anges, la tête aimantée par la main de l’être aimé, les quatre danseuses bras-dessus bras-dessous entremêlées en losange…
Au fait, le spectacle dont il est question ici est actuellement visible sur France.tv. C’est bien pour se faire une idée mais il me semble nettement préférable de franchir la porte du Théâtre national de la danse à Chaillot, tout comme il vaut mieux aller au restaurant que regarder des émissions de cuisine (en mangeant des chips !). Mais si cela peut vous donner faim de danse, j'en serais ravi !
Jusqu’au 26 juin 2021
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Extraits musicaux Piotr Ilitch Tchaïkovski
Costumes Igor Chapurin
Vidéo Boris Labbé
Lumières Éric Soyer
ODETTE - ODILE Isabel García López
SIEGFRIED Leonardo Cremaschi
MÈRE DE SIEGFRIED Clara Freschel
PÈRE DE SIEGFRIED Baptiste Coissieu
ROTHBART Antoine Dubois
Tarif C — de 8€ a 43€
Exécuteur 14, Adel Hakim, Swann Arlaud, Rond-Point


Rituel païen pour la paix:
Vendredi 16 octobre, la veille du couvre-feu et le jour de l’assassinat de Samuel Paty - Paix à son âme - j’ai retrouvé les fauteuils en rangs serrés de la petite salle du Théâtre du rond-point (la salle Jean Tardieu), pour un seul en scène, dont la forme est toujours un défi pour l’acteur, mais j’y reviendrai, ce qui m’a permis de renouer avec un rituel que j’avais depuis longtemps abandonné.
D’abord, j’ai lu cette phrase au fronton du théâtre : « Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud ont fait de ce lieu un théâtre. » Une brèche s’ouvre, une profondeur apparaît vers le passé: ce lieu n’a pas toujours été un théâtre. Sous-entendu il ne le sera peut-être plus dans 10 ou 100 ans, il faut le soutenir. Et aussi: il faut rendre hommage aux créateurs et aux passeurs, il a fallu en déployer de la volonté et de la passion pour transformer un « lieu » en espace de culture et de démocratie, et le transmettre jusqu’à nous, spectateurs de 2020. Je continue mon pèlerinage en flânant dans la librairie, où l’on a intelligemment disposé, du moins à l’entrée, des livres « par couleurs ». Quelques étagères de couvertures « jaunes » pour répondre à ceux qui cherchent « je ne sais plus quel titre mais la couverture était jaune! ». Est-ce que ce n’est pas un exemple de pensée disruptive? Peut-on imaginer une bibliothèque entière classée par couleurs? Une autre brèche s’ouvre: on pourrait changer nos habitudes en donnant les rênes à l’imagination... À la librairie, on offre des carnets de note: un cadeau, merci! Je tombe sur un livre depuis longtemps recherché : Just kids de Patti Smith, et je commence à dévorer le petit livre de Pierre Notte: L’Effort d’être spectateur, qui m’offrira un réconfortant sentiment d’appartenance. Je ressors les poches pleines comme j’aime de livres et de carnets et je m’apprête à descendre l’escalier. Mais avant, je lève la tête, comme mon professeur bien aimé de Latin-Musique-Français me l’a appris au collège. C’est important de lever le nez aussi souvent que possible. Ça permet de sortir la tête du sable, et accessoirement de rêver...
Si on lève la tête avant de descendre l’escalier, on aperçoit un vestige de l’époque Renaud-Barrault: un morceau de charpente qui semble finement ouvragée et monumentale à la fois. Je pense à la salle du Théâtre du Vieux Colombier où la charpente dessine la coque d’un bateau retourné. Celle du rond-point semble tout à fait ronde, comme le miroir d’un parquet de bal. C’est peut-être un détail pour vous, mais c’est exactement le genre de détails qui décuple mon plaisir et semble enrichir mon expérience de spectateur.
Je pénètre dans la petite salle, il y a encore peu de monde, je laisse un siège d’écart de chaque côté; je m’étale un peu: les genoux touchent le dossier du siège devant moi, qui est occupé, c’est contrariant, mais d’après Pierre Notte, c’est ainsi, sous la contrainte, qu’on reste éveillé! J’accepte donc cette contrainte de bonne grâce...
L’ouvreuse descend au premier rang et nous adresse ses recommandations concernant téléphone portable et covid. Parmi les préliminaires au rituel théâtral, c’est celui que j’aime le moins. On est à un moment incertain où le spectacle n’a pas encore commencé mais où, cependant, quelqu’un s’adresse aux spectateurs rassemblés. C’est donc un entre deux, mi annonce officielle, mi entrée dans le jeu, que je ne comprends pas. Bien malin celui qui réinventera cette entrée en matière apparemment obligée !
Enfin trêve de bavardages : lentement l’obscurité tombe dans la salle. Avant que la scène ne s’éclaire, je savoure ce moment de suspense unique. Que va-t-on me raconter ce soir?
Quand la scène s’allume, Swann Arlaud est apparu, il trône sur un échafaudage côté jardin. Il trône comme un enfant sur les ruines. Au début, je me demande: «D’où jaillit cette parole? » surtout parce que le récit est à l’imparfait. Je me demande: « A quoi a-t-il survécu ? ». A ce stade, j’ai porté un jugement : j’ai pensé que l’acteur, à force de chercher une voix différente de celle de Jean-Quentin Châtelain, avait cherché trop loin du côté d’une certaine neutralité, ce qui me gênait un peu. J’ai pensé qu’il incarnerait « mieux » son personnage si je pouvais sentir, par exemple, de l’ironie, dans sa voix. Mais l’histoire m’a montré que d’ironie, il ne peut pas y en avoir sous les bombes, dans la survie, dans la ruine. Alors, je me suis dit que je devais faire confiance à l’acteur, c’est lui qui conduisait ce soir. On a vanté l’accompagnement sur scène du musicien Mahut. Je l’ai trouvé original et plutôt bien fondu dans l’ensemble. Mais je retiens aussi le travail de la lumière. C’est un huis clos. Si on est parfois en extérieur, ce n’est qu’en imagination! Alors comment varier les atmosphères sinon en inventant des lumières nouvelles ? J’aime quand Swann Arlaud est assis, affalé contre un dossier, aux trois-quarts tourné vers le fond de scène, face à un miroir en pied, tout sale. La lumière semble émaner du miroir, ou reflétée par lui, elle trace un rayon jaune poussière jusqu’à l’acteur assis.
Les cinq dernières minutes forment une apothéose. Comme dans l’eucharistie, l’offrande de l’acteur met tout le monde d’accord: les plus sceptiques sont comblés, les tousseurs sont pardonnés, la salle tendue boit les paroles et s’émeut comme un seul homme. Globalement la forme du spectacle est un lent crescendo. Je ne pense pas que ça s’accélère, je pense que ça monte lentement en intensité pour exploser à la fin. Ça, ça me plaît beaucoup. Ça m’a cueillie.
Swann Arlaud est un canal assez pur pour faire entendre la langue nouvelle de Adel Hakim (ça aussi c’est un prodige : cette pièce éditée en 2005 fait jaillir une langue toujours neuve!), mais en plus, il atteint un sommet d’émotions dans un abandon total. Il semble littéralement s’embraser dans l’œil de la poursuite.
C’était très beau. J’étais venue pour des retrouvailles, j’ai été gâtée.
Jusqu'au 23 octobre 2020
Théâtre du Rond-Point
Faites vous plaisir: les théâtres ont révisé leurs horaires, c’est encore possible de sortir avant le couvre-feu!
Exécuteur 14, de Adel Hakim, avec Swann Arlaud, mise en scène de Tatiana Vialle, au Rond-point c’est fini mais surveillez la tournée!
Prochainement au Théâtre du Rond-point : Madame Fraize, avec Marc Fraize (du 28 octobre au 28 novembre) et Départ volontaire, de Rémi de Vos, avec notamment Micha Lescot (du 3 au 29 novembre).
L’effort d’être spectateur, Pierre Notte, Solitaires intempestifs

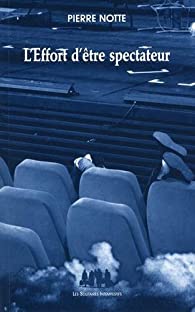
Vendredi dernier je suis retournée au théâtre du rond-point, pour voir Exécuteur 14, une super pièce. J’ai eu un peu de mal à rentrer dedans mais la magie a opéré et à la fin toute mon attention était tendue vers cet être flamboyant: l’acteur seul en scène dans l’œil de la poursuite...
J’ai noyé mon masque de larmes, j’ai étalé mes genoux et mes coudes grâce aux gestes barrière, ce furent de belles retrouvailles.
Malheureusement le lendemain j’ai appris l’assassinat de Samuel Paty et tout m’est revenu de novembre 2015: je sors du théâtre (l’Usine Hollander à Choisy-le-Roi) où j'avais vu la pièce, là aussi remarquable, Jeunesse sans Dieu de Von Horvath, sur la montée du nazisme... et j’apprends l’attaque en cours au Bataclan, la nuit d’attentat au cœur de Paris...
J’en ai tellement marre que le théâtre soit si prophétique, que l’horreur de la réalité dépasse celle de la fiction! J’ai la trouille d’aller au théâtre maintenant, je l'avoue.
En flânant à la librairie du Rond-Point je suis tombée sur ce livre un petit livre dense et intense de Pierre Notte, c’est son premier « essai » théorique sur le théâtre, ça s’appelle L’effort d’être spectateur. Ça nous concerne absolument et je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu’il tente de cerner comme essentiel dans sa définition du théâtre.
C’est lui notamment qui avait mis en scène cette pièce que j’ai adorée au Théâtre de la Reine Blanche : La magie lente , une pièce de Denis Lachaud. Un seul en scène déjà, c’est une forme que j’affectionne.
Il termine son essai en soulignant cet effort supplémentaire, pour le spectateur de 2020, consistant à braver sa peur de sortir dans un lieu festif, ou de culture. Et il faut désormais s’arracher tôt aux tâches professionnelles, courir au théâtre et courir chez soi avant le couvre feu!
Mais on continuera toujours. Il suffit que je lise la Terrasse, et de multiples envies me réchauffent et m’animent: je vis, je respire, je sors au théâtre !
On devrait moins critiquer les spectacles, et davantage partager notre expérience aimante de spectateur : le rituel de la lumière qui descend dans la salle et qui monte sur la scène; la qualité de silence accordée ; la communauté des spectateurs et le type d’expérience qui les relie; la chaleur éventuelle, la torpeur éventuelle, l’ennui éventuel! Qui ne peut pas effacer les autres composantes du rituel...
Bref j’ai hâte de retourner au théâtre!
L'effort d'être spectateur, Pierre Notte
88 pages
Éditeur : Les Solitaires Intempestifs (14/11/2016)
Nos solitudes, Julie Nioche, Maison des Métallos


Pour cette nouvelle saison, la résilience est à l’honneur à la Maison des Métallos. À cette occasion, la chorégraphe Julie Nioche propose une reprise de son spectacle Nos solitudes créé en 2010.
Julie Nioche et Lisa Miramond alternent pour offrir une performance riche en tensions. Nous les retrouvons attachées par de longs fils invisibles à une structure au plafond au milieu d’un rideau de deux cents poulies. Elles s’harnachent les pieds, la taille et les mains.
Le corps humain est le vecteur du rythme mécanique de l’ensemble corps/poids. Un bras se lève, des poids se baissent. Le corps se hisse de centimètre en centimètre alors que les contre-poids se rapprochent du sol. Au fur et à mesure, les forces en place s’inversent pour proposer une nouvelle gravité.
Le rythme du corps s’accélère démontrant une parfaite maitrise de la répartition de son poids dans son corps et de l’impact qu’il génère sur son environnement. Au fur et à mesure, on en arrive même à en oublier toute la machinerie pour concentrer notre regard sur le corps. Ce corps qui est tantôt en mouvement tantôt s’abandonne à la rêverie ou au sommeil.
Cette symbiose poétique s’interrompt brutalement, comme une allégorie de l’être humain qui ne contrôlerait plus l’environnement dans lequel il se trouve et qui, par ses actions, aurait contribué à l’effondrement de celui-ci.
On peut également l’interpréter positivement en y voyant l’échappée de l’être humain, une liberté retrouvée face à un système qui ne lui conviendrait plus.
Alexandre Meyer contribue à l’ensemble en y ajoutant quelques notes de guitare qui viennent accompagner le rythme de ce spectacle composé en trois temps.
Particulièrement conquise par le concept visuel et l’idée sous-jacente proposée, on reste néanmoins sur sa faim quant aux possibilités qui auraient pu être proposées.
Conception, chorégraphie Julie Nioche
Interprétation (en alternance) Julie Nioche, Lisa Miramond
Musique et interprétation Alexandre Meyer
À la Maison des Métallos Paris jusqu’au 18 octobre.
Crise de nerfs, Anton Tchekhov, Peter Stein, Théâtre Montansier


Quel plaisir de retourner au théâtre !
Quel plaisir de retrouver la magnifique salle du Théâtre Montansier ! Et quelle drôle de sensation que de contempler (la faute à la distanciation physique) un public éparse et étrangement uniforme (masque blanc couvrant le visage oblige). Pour un peu, l'on se croirait projeté dans une pièce de Beckett ou sur l'affiche de Réalité (le film de Quentin Dupieux).
Néanmoins, dès la lumière éteinte et une fois cette étrange atmosphère assimilée, on se plonge avec délice dans les trois micro-pièces d'Anton Tchekhov proposées par Peter Stein. On est d'autant plus concentré que, merci le Covid, plus personne n'ose tousser ; comme quoi c'était possible !
Dans « Le Chant du cygne », l'absence totale de décor (les murs sont bruts, comme aux Bouffes du Nord) et l'éclairage à la bougie soulignent le caractère crépusculaire du personnage incarné par Jacques Weber : un comédien vieillissant qu'on a littéralement oublié dans un théâtre.
Jacques Weber, volontiers tonitruant, semble avoir du mal à camper ce personnage désabusé oscillant entre désespoir et bouffonnerie : « J'ai 70 ans, c'est déjà Ding-ding, on ferme ».
C'est comme si le metteur en scène et le comédien n'avaient pas trouvé le bon rythme pour une pièce qui, bien que courte, s'étire en longueur.
Heureusement, la deuxième pièce, intitulée « Les méfaits du tabac », est bien plus réussie. Jacques Weber, seul en scène, se réveille (et du coup, les spectateurs aussi!) et nous amuse avec un exposé sur le thème du tabac dont le sujet dérive bien vite sur la femme du conférencier : « elle est toujours de mauvaise humeur (…) elle m'appelle l'épouvantail ». Ici encore la pièce est douce-amère : on s'amuse drôlement de la descente aux enfers que constitue la vie du personnage. Il faut dire que Weber a trouvé le bon tempo et qu'il est délicieux et juste,
Pour la troisième et dernière farce, l'on se dit que les deux autres comédiens vont servir de faire-valoir à la star Weber ; or c'est tout l'inverse, Jacques Weber se met au service de ses partenaires Manon Combes et de Loïc Mobihan, un formidable duo de jeunes comédiens.
Dans « Une demande en mariage », un jeune homme émotif, obséquieux et pragmatique (« Si l'on attend l'amour véritable, on ne se mariera jamais ») demande la main de la fille de son voisin et ami. Mais ses hésitations et circonlocutions vont lui faire commettre un impair qui va bientôt mettre son projet en péril. Alors que le père lui donnait au départ des petits noms tendres (ma bichette, ma mignonne...), sa relation avec sa promise s'envenime jusqu'à la crise de nerfs, crise de nerfs qui donne l'occasion à Loïc Mobihan et, surtout, à Manon Combes d'exprimer pleinement leur talent dans un numéro débridé et désopilant.
Il y a un véritable crescendo dans la mise en scène des trois pièces et, si la mort rode au départ (ce qui correspond assez bien à l'ambiance Covid), l'on ressort du théâtre tout ragaillardi et avec une pêche d'enfer ; le spectacle vivant porte ici bien son nom.
La Quatrième dimension

Youpi ce sont les vacances. On retrouve nos vieilles VHS et des petites pépites des eighties. On commence par un must, inégal, mais réunissant de grands noms de l'époque.
L'histoire: Adaptation et hommage à la célèbre série de Rod Serling. Le films se découpe en quatre histoires plus ou moins inquiétantes mais qui ouvre sur une nouvelle dimension!
Le réalisateur: Le projet a bel et bien réuni les stars de l'époque. Spielberg a révolutionné la science fiction avec Rencontres du 3e Type puis E.T. George Miller s'est fait un nom avec ses deux Mad Max. Joe Dante est le petit frère terrible de Spielberg. Enfin John Landis a connu deux succès avec les Blues Brothers et Un fauteuil pour Deux.
L'anecdote: elle n'est pas très drôle. Sur le papier, le projet était tout simplement incroyable. Dans les faits, le film est connu pour être un bide et surtout il a failli couté la carrière de John Landis. C'est sur le tournage de son sketch que son acteur principal et deux enfants ont trouvé la mort. Un terrible drame d'hélicoptère. La procédure judiciaire a duré plus de dix ans et a bien pourri la vie de John Landis, souvent accusé d'avoir pris des risques énormes. Bref, on n'est pas loin du film maudit finalement.
Les acteurs: Film à sketchs, La 4e Dimension a donc un casting varié et toujours amusé. Chez Joe Dante, on retrouve ses vieux complices comme Dick Miller ou Kevin McCarthy (ainsi que la très belle Kathleen Quinlan). Miller choisit le mystérieux John Lightow. Dan Aykroyd joue à se faire peur avec Albert Brooks...
Pourquoi on aime: Le film est donc une tache d'huile dans les carrières respectives des auteurs. John Landis est amusant mais il n'est pas inspiré. Il filme sagement. Spielberg se loupe avec son sketch gentillet sur des petits vieux qui retrouve leur ame de gosse. Heureusement tout s'éclaire avec une Joe Dante, survolté qui rend hommage aux dessins animés de son enfance et ne se renie jamais. Quant à George Miller, il prouve toute son efficacité avec un sketch qui surpasse tous les autres. Par son concept, le film est inégal mais il y a un charme certain et une sincérité de rendre hommage à une série que de toute facon a influencé d'une manière ou d'une autre
Warner Bros - 1983
Les oiseaux par les grands maîtres de l’estampe japonaise, Anne Sefrioui, éditions Hazan

Dans un écrin de tissu rouge vif s’ouvre devant nos yeux éblouis une envolée
d’oiseaux, œuvres des plus grands maîtres de l’estampe japonaise.
La population des oiseaux, toutes de plumes de becs de
beauté, se découvre pli après pli le long de ce leporello, autant de battements
d’ailes pour approcher ce monde volant des passereaux, loriots, aigrettes et
chouettes.
Saisis entre les fleurs, les bourgeons, les saisons, en
mouvement ou endormis, seul ou en compagnie, chantant ou nous observant, les
oiseaux forment une frise délicate et poétique. Nous assistons aux miracles de
la nature, des miracles discrets, des miracles essentiels, que les maîtres de
l’estampe japonaise traduisent en des finesses de dégradés, de détails et de
vie.
Le livret qui accompagne ce grand souffle de liberté, écrit
par Anne Sefriou, retrace l’histoire de l’estampe japonaise et le rapport
étroit qui unit les artistes à la nature. Ici, nous sommes invités à pénétrer
dans le monde du kacho-ga,
« images de fleurs et d’oiseaux », le monde au-dessus de nos têtes,
qui relie le ciel et la terre, ce monde de chants et de légèreté.
Chaque œuvre est le fruit d’une étroite collaboration artistique entre le dessinateur, le graveur, l’imprimeur et l‘éditeur, quatuor au service d’une œuvre raffinée, au service des oiseaux.

Composer en danse, Yvane Chapuis, Myriam Gourfink, Julie Perrin, Les presses du réel


Dix chorégraphes dressent une cartographie de l’écriture de la danse où nous sommes invités à voyager, de verbes en actions, d’expériences en pratiques.
« Mais quand on n’est pas un
danseur ; quand on serait bien en peine non seulement de danser, mais
d’expliquer le moindre pas ; quand on ne possède, pour traiter des
prodiges que font les jambes, que les ressources d’une tête, on n’a de salut
que dans quelque philosophie », écrit Valéry dans sa Philosophie
de la danse (1939).
« ADRESSER »
Si l’ouvrage Composer en danse n’est pas à proprement parlé un
ouvrage de philosophie, il répond cependant à la question jusqu’ici sans
réponse : qu’est-ce que la danse ? « Il est beaucoup plus simple de construire un univers que
d’expliquer comment un homme tient sur ses pieds. » (ibid.)
Et comment il danse, pourrions-nous ajouter.
« CHOISIR »
Livre infini, sorte d’encyclopédie du mouvement dans ses états
exceptionnels, dans une durée faite d’énergie et d’instabilité, Composer en
danse est le livre des vies intérieures, dans une perspective aussi bien
historique que contemporaine.
« CITER »
Par des pensées savantes et spontanées, élaborées et souvent parallèles
- car elles abordent tous les champs de la création, les dix chorégraphes
esquissent des pas d’interrogation, des pas de réflexions, à travers les
expériences vécues dans leur corps même, dans leur langue, leur mouvement, leur
scène, leurs échanges.
« COLLECTIF »
Les chorégraphes jouent et se jouent de la pesanteur, et les définitions
qu’ils nous livrent ici permettent l’observation, mais aussi l’approche de cet
autre monde.
Les
actions qui produisent l’œuvre, son rythme, sa poésie, se déclinent en repères
formant autant d’entrées et de références : ainsi nous allons, au gré de
nos propres trajectoires, de l’organique
au logique, de l’humain à l’animal, du spectateur au danseur.
« CONTRAINTE »
Invitation permanente, le livre dans son ampleur créé les terminaisons
nerveuses qui facilitent notre immersion dans cet art.
« DRAMATURGIE »
Production incessante de travail, l’état dansant active un vocabulaire
qui lui est absolument propre. Singulier et sans cesse sur l’arête des mots et
des sensations, ce vocabulaire compose une syntaxe motrice qui articule le
mystère des corps.
« ESPACE »
Enfin, signalons la beauté plastique du livre, sa mise en page graphique
et iconographique, montage de haute qualité, où l’œil et l’esprit circulent
aisément.
Les verbes cités en tête de paragraphe sont extraits de la table des matières du livre.
Composer en danse – Un vocabulaire des opérations et des pratiques
Yvane Chapuis, Myriam Gourfink, Julie Perrin
Les presses du réel, 2019
Gainsbourg, 5 bis rue de Verneuil, Marie David, Plon

Tous les fans de Gainsbourg ont entendu parler de sa maison située au 5 bis rue Verneuil à Paris, aux murs noirs et aux objets étonnants. Certains ont même couvert d’inscriptions la façade du lieu.
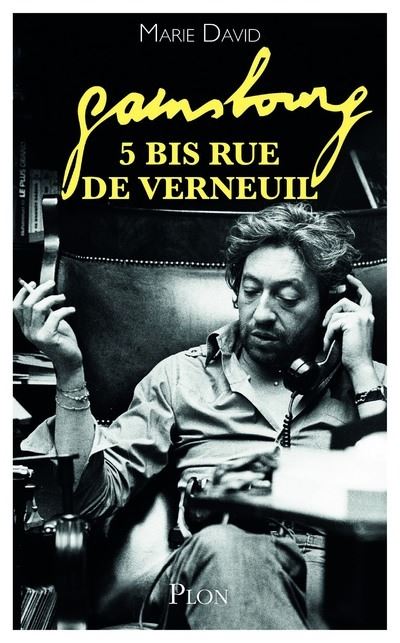
Marie David a choisi d’évoquer
le grand Serge à travers le prisme de ce lieu et de ce qu’il représentait pour
lui. Acheté et pensé au départ pour Bardot, c’est finalement Jane qu’il a
accueillie. Avec sa fille Kate et bientôt Charlotte. Sans oublier son fidèle
chien et son majordome. C’est un autre Gainsbourg que la réalisatrice nous
donne à voir avec justesse et pertinence. La réalisation d’un documentaire sur
l’artiste lui a donné envie d’écrire sur la face cachée de l’homme. Et surtout
de la relation qu’il entretenait avec sa maison. C’est là qu’il a passé dix ans
avec Jane, qu’il a accueilli ses amis — dont Françoise Hardy et Jacques
Dutronc—, c’est là qu’il a collectionné des objets, composé ses musiques. Dans
cet univers où chaque objet avait sa place, où le faux brouillon pouvait
dévoiler son goût pour la rigueur et la précision, un certain sens du
rangement, il avait fait installer deux pianos. Il y recevait aussi parfois
quelques rares fans.
Le livre est pensé comme
un documentaire, précis et chronologique, du jeune auteur encore timide qui
rêvait de vivre « chez lui » à l’artiste malade qui souffrait de
solitude. Un voyage dans la tanière de l’homme à tête de chou, de l’amant de
Melody et de l’amoureux de BB.
Cet antre était son refuge lorsqu’il perdait confiance et ne croyait plus en son travail. Lorsque la reconnaissance n’était pas au rendez-vous. Plus tard, quand ce sera le cas, c’est là que Vanessa Paradis ira y préparer l’album « Tandem ».
Gainsbourg est ici devenu Gainsbarre, souvent insupportable et vulgaire, son double torturé. Parmi ses souvenirs et ses objets, c’est rue de Verneuil qu’il est mort il y a trente ans. Seul.
Le livre de Marie David aborde
tout en délicatesse ces thèmes et d’autres encore, au travers de chapitres qui
fourmillent d’anecdotes et de petits secrets. Il est juste un peu regrettable
qu’on y trouve de temps à autre des fautes d’orthographe et de syntaxe.
Richard Jewell, Clint Eastwood

J'ai enfin pu voir l'excellent dernier opus de "ce bon vieux Eastwood" qui n'a rien perdu de sa lucidité et de sa capacité d'indignation contre les travers de son époque.

J'ai enfin pu voir l'excellent dernier opus de "ce bon vieux Eastwood" qui n'a rien perdu de sa lucidité et de sa capacité d'indignation contre les travers de son époque.
Travers qui affectent son pays depuis fort longtemps et le nôtre aussi, désormais sous contrôle de l'hypocrisie d'une bien-pensance mondialisée alliée naturelle d'une idéologie dominante anglo-saxonne partout répandue grâce à la puissance de médias chiens de garde zélés (et pour cause !) d'un monde soumis aux marchands. Il y a beau temps que le journalisme digne de ce nom n'existe plus aux USA. Logiquement, il est à l'agonie ailleurs, en voie de disparition.
Eastwood, dans son film, ne montre pas un emballement médiatique qui serait épisodique. Il montre ce que font les médias quotidiennement. Ce qu'ils font c'est ce qu'ils sont. Ils ne sont pas menteurs, ils font ce pourquoi ils sont grassement payés, raconter des histoires (comme le cinéma) quels qu'en soient les conséquences. Nul besoin de décrire un quelconque mécanisme pour éclairer la lanterne du spectateur sur les médias. Chacun les voit à l'œuvre, en est la victime même et surtout quand il s'imagine qu'il ne l'est pas. Ce qui est proprement consternant et hélas sans issue puisqu'accepté et justifié par le troupeau docile et confiant dont ils ont la charge. Troupeau dont fait partie ce pauvre Mr Jewell, soudain contraint de mettre en doute un système dans lequel il croit. Il va y être aidé par un avocat, looser sympathique revenu de tout, figure classique du cinéma américain généralement sous l'apparence désabusée du détective privé. C'est ce personnage qui osera balancer quelques vérités bien senties à la face de la journaliste qui sera bien en peine d'argumenter quoi que ce soit pour se défendre puisque l'irresponsabilité est son gagne-pain.
La retenue
dans le traitement de l'émotion, signature du cinéma eastwoodien, ne se
dément pas. Paul Walker Hauser est étonnant de justesse dans son rôle
ingrat de benêt yankee amateur d'ordre, professant une foi naïve dans les
institutions légales de son pays, voulant bien faire, bientôt trahi, maltraité,
déconsidéré par cela même qu'il révérait. Kathy Bates, sa maman, est admirable
de retenue dans ce bouleversement brutal de l'existence paisible qu'elle
essaie de mener. Les larmes versées ne le sont jamais de trop, préserver sa
dignité, cette dignité des pauvres gens tellement maltraitée de nos jours, et
celle de son fils étant plus fort que tout. Le délicieux Sam Rockwell joue
l'avocat avec décontraction, empathie et fatalisme, c'est à lui que l'on
s'identifie volontiers, il nous fait du bien face aux affreux jojos. Ceux-là
sont un couple : une journaliste qui ne sait pas écrire, reconnaissant
elle-même qu'elle écrit comme un pied, mais qui sait dénicher un scoop (et on
ne lui demande pas autre chose aujourd'hui), y compris en allant fouiller
dans le pantalon d'un agent fédéral peu scrupuleux (ce qui n'a rien
d'irréaliste eu égard à ce que l'on voit dans l'actualité), et
celui-ci, affecté à la surveillance des festivités, qui s'y ennuie au lieu de
faire le job dont il avait la responsabilité. Ce sont des types, évidemment,
nous sommes au cinéma où la typologie est la règle en particulier aux USA. Sauf
qu'il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'un conte, mais d'une histoire vraie
où ces types de personnage ont existé et sévi. Les comédiens qui les incarnent
sont impeccables, hypocrites y compris vis à vis d'eux-mêmes, normal puisque
c'est l'image que l'on veut donner et se donner qui prime, veules, normal
aussi, avides de reconnaissance (comme le dernier des peigne-culs
aujourd'hui à la télé ou sur les réseaux dits "sociaux"),
irresponsables revendiqués qui enverraient tranquillement un homme à la mort en
murmurant la larme à l'œil "I'm sorry"...
Ce film est à rapprocher de "Sully" du même Eastwood. Mais tout son cinéma est de cette veine avec peut-être ces dernières années une mélancolie plus appuyée, l'âge sans doute, devant l'évolution de la société de son pays vautré dans un hédonisme nihiliste, le même qui nous détruit chez nous aussi puisque désormais, nous sommes comme tout le monde c'est-à-dire anglo-saxons... Nous fûmes gallo-romains, nous voici gallo-ricains pour reprendre l'expression pertinente de Régis Debray (un galopin !).
La mise en scène de mon ami Clint est rigoureuse, limpide. Il s'agit d'exposer un cas de société significatif, pas de réaliser un exploit cinéphilique. En d'autres temps nous aurions pu évoquer le cinéma-vérité. Plus simplement et donc plus justement, Clint nous donne à voir le récit de cette histoire stupide qui aurait pu très mal tourner pour un homme innocent à tous les sens du mot. Il nous la donne avec le moins d'artifice possible (si d'aucuns sont venus pour voir une explosion mémorable, je recommande qu'ils choisissent la salle 1 où "Avengers : end game" les ravira !). Pourquoi donc à votre avis ? Pour nous faire mourir d'ennui ? Parce qu'il ne sait pas faire ? Que celles et ceux qui le croient passent leur chemin. Je vous le dit pourquoi, bien que ça saute aux yeux : pour faire réfléchir tant qu'on le peut encore sur nous-mêmes, sur la vie des hommes et des femmes dans nos sociétés occidentales, telle que nous l'avons bâtie. Et sur les valeurs que nous avons sciemment sacrifiées pour une telle vie de lucre et d'oubli du reste, ce reste qui reste en travers de la gorge des quelques êtres humains encore libres c'est-à-dire en éveil, l'œil sévère et la parole sans complaisance avec ce temps de la furie médiatique d'où toute intelligence critique est bannie. Ce temps où la morale du caniveau a pignon sur rue.
Eastwood, le vieil Eastwood, est le seul à faire ça aujourd'hui. S'adresser à des adultes lorsqu'on ne veut plus entendre parler d'adultes. Où l'injonction est de rester éternellement un gamin à épater. C'est tellement plus facile pour refiler toutes sortes de camelote qui rapportera gros. Eastwood, le vieil Eastwood, imperturbable, inactuel, intempestif, porte son regard sur les petites gens, ceux que l'on moque volontiers, les beaufs, qui n'ont pas encore compris (qu'est-ce qu'ils sont cons !) que la chasse a mauvaise presse, qu'insister sur le fait que tu n'es pas homosexuel pourrait être très mal interprété, que tu devrais bien t'excuser sur les ondes d'avoir jadis sifflé une femme à son passage tant elle te paraissait belle, que tu devrais aussi mettre à la déchetterie ta collection de Brassens, ce mec qui chantait des horreurs à pleins poumons, et tes bouquins écrits par d'odieux personnages, etc, etc, etc.
Aussi
incroyable que ça puisse paraître, tout ça se trouve dans ce film de Clint
comme aussi dans ses autres opus sous couvert d'autres histoires. Mais au
fond ce ne sont sans doute que des histoires. Des histoires qui sont
de la vie et la vie, quel cinéma !
Voilà, mes amis, quel est mon sentiment à propos de ce film. Mon Cher Thibault, lorsque je suis allé le voir j'avais bien en tête tes reproches. J'ai identifié les éléments qui te les inspiraient et qui auraient pu être opérants dans le cas d'un film tel qu'un jeune réalisateur le concevrait aujourd'hui. Mais ils ne m'ont pas paru pertinent à l'endroit du travail d'Eastwood qui, en bon classique, et de plus en plus ne cherche qu'à exposer le plus clairement possible, sans complaisance ni affèterie, une situation qui l'a interpelée et qu'il juge insupportable.
Sans doute,
mes amis, une longue fréquentation de la carrière d'Eastwood, parce qu'on
l'aime, fait qu'on finit par le voir venir. Une familiarité se crée, on le
comprend. Et lorsqu'on a compris, on n'a plus envie de juger. Ceci ne vaut pas
que pour les artistes que l'on aime au cinéma mais pour tout domaine de
l'Art. Enfin, c'est ainsi que je vois les choses. Je suis un
bien piètre critique !
J'espère ne pas avoir à vos yeux gagné le grand prix du "Parfait Raseur" sur plus de dix lignes !



